Omar Aktouf
Omar Aktouf est un intellectuel québécois d'origine algérienne, professeur titulaire à HEC Montréal. Il est membre fondateur du centre humanismes, gestion et mondialisation et membre du conseil scientifique d'ATTAC Québec.
Professeur titulaire de management à l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal et membre fondateur du Groupe Humanisme et Gestion. Il est régulièrement invité auprès de nombreuses universités d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine.
Suite à ses études en psychologie, en gestion/économie du développement et en management, il a développé plusieurs domaines d’intérêt, soit la culture d’entreprise, la gestion par projets, la recherche critique sur les théories et les pratiques en gestion, la recherche sur le symbolisme et les activités de parole dans les organisations, la méthodologie et la pédagogie des sciences de l’administration. Auparavant, M. Aktouf a assumé diverses responsabilités de gestion, d’administration du personnel, de gestion de projets et de haute direction dans plusieurs sociétés, dont une importante entreprise pétrolière. Il mène, par ailleurs, une importante carrière de conférencier et consultant international. M. Aktouf est l’auteur de nombreux articles et de plusieurs livres dans le domaine de la gestion (dont, en particulier, Le management entre tradition et renouvellement.
Titre : La stratégie de l’autruche, post-mondialisation, management et rationalité économique
Auteur : Omar Aktouf
Genre : Économie et management
Date : 2002
Pages : 353
Éditeur : Les éditions écosociété
Collection : -
ISBN : 2-921561-67-0
Lorsque 3 milliards d'individus - soit la moitié de la planète - «vivent» avec moins de 3 $ par jour, que 225 milliardaires possèdent l'équivalent de l'avoir de 2 milliards de personnes, que 51 sociétés figurent parmi les 100 premières «économie» du monde, que l'économie mondiale est à 90% spéculative, que la masse financière (hors actions et obligations) circulant quotidiennement représente 10 fois la valeur des réserves cumulées de toutes les banques centrales du monde...est-on encore loin du non-sens absolu?
En ce début du XXIe siècle, des voix s'élèvent contre le trop grand nombre d'erreurs commises dans la conduite des affaires économiques mondiales. Peut-on parler de simples erreurs de calcul et de prévision? Certes non. Il s'agit de fautes, de fautes économiques et gestionnaires graves, qui touchent à la conception même de notre monde et de son fonctionnement. Est-ce là chose réparable par d'autres calculs et prévisions, en utilisant les mêmes prémisses et les mêmes schémas d'analyse?
Partant du constat d'échec cuisant des «trois révolutions de la modernité» (révolution industrielle, automatisation et informatisation-information) dans leurs promesses de procurer à l'humanité confort, bonheur et satiété, l'auteur propose de modifier radicalement nos visions des choses... Mais ceux qui détiennent le pouvoir et les privilèges le souhaitent-ils? Admettrons-ils que tout, sur cette terre dominée par le management/économie, semble s'écrouler inexorablement? Pourtant, économistes et gourous du management - éternels complices - continuent à garder la tête dans le sable... tout en nous expliquant pourquoi il est rationnellement justifié de faire l'autruche.
Extraits :
L’ENSEMBLE DE CE LIVRE est en grande partie matière retravaillée à partir de nombreux articles soumis, depuis environ cinq ans, à diverses revues liées au domaine de l'économie et du management, autant en Europe qu'en Amérique du Nord. Tous, sans exception, ont été rejetés et, souvent, immédiatement renvoyés par retour de courrier après simple examen préliminaire de la part des chefs de rédaction. Or, ce n'était pas le cas pour les nombreux articles où je m'attachais surtout à déconstruire et à reconstruire le management « traditionnel » et à décortiquer les bases de modèles différents ou « renouvelés » : les textes systématiquement refusés sont ceux dans lesquels je m'essaie à critiquer plus en profondeur les fondements mêmes du système dominant ; et je ne peux qu'en conclure à une inquiétante, sournoise et grandissante frilosité intellectuelle devant la pensée critique, de la part des revues du domaine.
Omar Aktouf, La stratégie de l’autruche, Post-mondialisation, management et rationalité économique, page 19
Le second problème est d'ordre épistémologique : il y a ignorance totale de différences de réalités. Lorsqu'on sait (depuis Max Weber au moins, voir notamment Économie et société) que le service public — l'État — obéit à une « logique de compte de budget » (l'objectif étant l'équilibre), tandis que l'entreprise privée à but lucratif, elle, obéit à une « logique de compte de bilan » (l'objectif étant la réalisation de bénéfices), comment peut-on prétendre juger l'État à l'aune des critères de l'entreprise privée, et en tirer argument pour dénoncer « l'inefficacité » de l'État, et même appeler à la privatisation tous azimuts ? Dire que le privé est « plus efficace » que le public n'a strictement aucun sens, car il s'agit d'univers dans lesquels « l'efficacité » ne se présente pas dans les mêmes termes, diffère en nature et en finalité. Ce n'est pas plus pertinent que de dire d'un poisson qu'il est plus efficace qu'une vache, en prenant comme cadre de référence de l'efficacité le milieu marin.
Omar Aktouf, La stratégie de l’autruche, Post-mondialisation, management et rationalité économique, page 103
J'aimerais, à ce propos, soumettre à la méditation du lecteur cet édifiant et si actuel discours du grand chef Seattle, de la tribu des Duwamish, prononcé en 1855 lorsque le président des États-Unis de l'époque, Franklin Pierce, demanda aux Indiens Duwamish de céder leurs terres à des colons blancs et offrit, en compensation, de les installer dans une réserve :
Mes paroles sont comme les étoiles...
Le grand chef de Washington envoie un message pour dire qu'il désire acheter nos terres. Le grand chef nous envoie aussi des paroles d'amitié et de bonne volonté. C'est là un geste bien aimable de sa part car, nous le savons, il n'a pas besoin de notre amitié.
Mais nous réfléchirons à son offre, car nous savons — si nous ne vendons pas — que l'homme blanc viendra peut-être, armé de fusils, et s'appropriera nos terres.
Comment peut-on acheter ou vendre le ciel — ou la chaleur de la terre ? Cette manière de penser nous est étrangère. Si nous ne possédons pas la fraîcheur de l'air ni le miroitement de l'eau, comment pouvez-vous nous les acheter ?
Nous prendrons notre décision.
Quand le chef Seattle parle, le grand chef de Washington peut se fier à ce qu'il dit, aussi sûrement que notre frère blanc peut se fier au retour des saisons.
Mes paroles sont comme les étoiles, elles ne s'éteignent pas.
Mon peuple vénère chaque coin de cette terre, chaque scintillante aiguille de sapin, chaque plage sableuse, chaque nuage de brume dans les sombres forêts, chaque clairière, chaque insecte qui bourdonne ; dans les pensées et dans la pratique de mon peuple, toutes ces choses sont sacrées. La sève qui monte dans l'arbre porte le souvenir de l'homme rouge.
Les morts des Blancs oublient le pays de leur naissance quand ils s'en vont pour cheminer sous les étoiles.
Nos morts n'oublient jamais cette terre merveilleuse, car elle est la mère de l'homme rouge. Nous faisons partie de la terre, et elle fait partie de nous. Les fleurs odorantes sont nos sœurs ; les chevreuils, le cheval, le grand aigle sont nos frères.
Les hauteurs rocheuses, les luxuriantes prairies, la chaleur corporelle du poney — et de l'homme — elles font toutes partie de la même famille.
Si donc le grand chef de Washington nous envoie son message pour dire qu'il pense acheter nos terres, il nous demande beaucoup.
Le grand chef nous fait savoir qu'il nous donnera un endroit où nous pourrons vivre agréablement et entre nous. Il sera notre père et nous serons ses enfants. Mais cela se peut-il jamais ?
Dieu aime votre peuple et a abandonné ses enfants rouges. Il envoie des machines pour aider l'homme blanc dans ses travaux et il construit pour lui de grands villages. Il rend votre peuple de plus en plus fort, de jour en jour. Bientôt vous inonderez notre pays, comme les eaux qui se précipitent dans les gorges après une pluie soudaine.
Mon peuple est comme une marée qui descend — mais qui ne remonte plus. Non, nous sommes de races différentes. Nos enfants et les vôtres ne jouent pas entre eux, et nos vieillards racontent d'autres histoires. Dieu est bien disposé à votre égard, et nous sommes des orphelins.
Nous réfléchirons à votre offre d'acheter nos terres. Ce ne sera pas facile, car, pour nous, cette terre est sacrée.
Ces forêts font notre joie.
Je ne sais pas, notre manière d'être n'est pas la même que la vôtre. L’eau scintillante qui bouge dans les ruisseaux et les fleuves n'est pas seulement de l'eau, mais le sang de nos ancêtres. Si nous vous vendons nos terres, vous devrez savoir qu'elles sont sacrées, et vous devrez apprendre à vos enfants qu'elles sont sacrées et que, dans l'eau limpide des lacs, chaque miroitement fugitif parle d'événements et de traditions que mon peuple a vécus.
Le murmure de l'eau est la voix de mes ancêtres. Les cours d'eau sont nos frères, ils étanchent notre soif. Les cours d'eau portent nos canoës et nourrissent nos enfants.
Si nous vendons notre pays, vous devrez garder ceci dans votre mémoire et l'apprendre à vos enfants : les cours d'eau sont nos frères — et les vôtres — et, dès ce moment, vous devrez accorder votre bonté aux cours d'eau, comme vous l'accordez à tout autre frère.
L’homme rouge s'est toujours retiré pour céder la place à l'homme blanc qui envahissait son pays, comme la brume du matin cède la place au soleil qui se lève. Mais les cendres de nos pères sont sacrées, le sol de leurs tombes est béni, il leur est consacré, et ainsi ces collines, ces arbres, cette partie de la terre nous sont consacrés.
Nous savons que l'homme blanc ne comprend pas notre manière d'être. À ses yeux, n'importe quelle partie du pays est semblable à l'autre, car il est un étranger, qui vient dans la nuit et prend à la terre toutes les choses qu'il lui faut. La terre n'est pas son frère, mais son ennemi, et lorsqu'il l'a conquise, il continue son chemin. Il laisse derrière lui les tombes de ses pères — et ne s'en soucie pas. Il vole la terre à ses enfants — et ne s'en soucie pas.
Oubliés, les tombes de ses pères et le patrimoine de ses enfants. Il traite sa mère, la terre, et son frère, le ciel, comme des objets faits pour être achetés et pillés, pour être vendus comme des moutons ou des perles luisantes.
Sa faim dévorera la terre et ne laissera rien qu'un désert.
Je ne sais pas — notre manière d'être n'est pas la même que la vôtre. La vue de vos villes fait mal aux yeux de l'homme rouge. Peut-être parce que l'homme rouge est un sauvage et qu'il ne comprend pas.
Dans les villes des Blancs, il n'y a pas de silence. Pas d'endroit où l'on puisse entendre les feuilles s'ouvrir au printemps ou les insectes bourdonner.
Mais peut-être est-ce ainsi parce que je suis un sauvage et que je ne comprends pas. Ce fracas, semble-t-il, ne peut qu'offenser nos oreilles. Que reste-t-il dans la vie, si l'on ne peut plus entendre le cri solitaire de l'engoulevent ou les chamailleries des grenouilles dans l'étang la nuit ?
Je suis un homme rouge et je ne comprends pas cela. L’Indien aime le doux bruissement du vent qui caresse l'étang — et l'odeur du vent, purifiée par la pluie de l'après-midi ou lourde du parfum des pins.
L’air est précieux pour l'homme rouge, car toutes les choses partagent le même souffle — l'animal, l'arbre, l'homme —tous, ils partagent le même souffle. L’homme blanc semble ne pas remarquer l'air qu'il respire ; comme un homme qui meurt depuis des jours, il ne sent plus la puanteur qui l'entoure.
Mais si nous vous vendons notre pays, vous ne devrez pas oublier que l'air nous est précieux — que l'air partage son esprit avec toute la vie qu'il contient. Le vent a donné leur premier souffle à nos pères, et il a recueilli leur dernier soupir. Et le vent devra aussi donner à nos enfants l'esprit qui les fera vivre. Et si nous vous vendons notre pays, vous devrez l'apprécier pour cette valeur particulière qu'il possède et pour son sol béni, l'apprécier comme un lieu où l'homme blanc sent, lui aussi, que le vent lui apporte le parfum suave des fleurs de la prairie.
Quant à votre demande d'acheter notre pays, nous y réfléchirons, et si nous nous décidons à accepter, c'est à une condition : l'homme blanc devra traiter les animaux du pays comme ses frères. Je suis un sauvage et je ne l'entends pas autrement.
J'ai vu mille bisons en train de pourrir, abandonnés par l'homme blanc, tués à coups de fusil à partir d'un train qui passait. Je suis un sauvage et je ne peux pas comprendre comment le cheval de fer fumant devrait avoir plus d'importance que le bison. Le bison, nous le tuons seulement pour pouvoir continuer à vivre.
Qu'est l'homme sans les animaux ? Si tous les animaux étaient partis, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit. Tout ce qui arrive aux animaux arrivera bientôt à l'homme aussi. Les maux qui touchent la terre touchent aussi les fils de la terre.
Vous devrez apprendre à vos enfants que le sol sous leurs pieds est fait des cendres de nos grands-pères. Et afin qu'ils respectent le pays, dites-leur que la terre est remplie des âmes de nos ancêtres.
Apprenez à vos enfants ce que nous apprenons à nos enfants : la terre est notre mère. Les maux qui touchent la terre touchent aussi les fils de la terre. Si les hommes crachent sur la terre, ils crachent sur eux-mêmes.
Car ceci nous le savons, la terre n'appartient pas aux hommes, l'homme appartient à la terre. Ceci, nous le savons.
Toutes les choses sont liées entre elles, comme le sang qui lie tous les membres d'une famille. Tout est lié. Les maux qui touchent la terre touchent aussi les fils de la terre. Ce n'est pas l'homme qui a créé le tissu de la vie, il n'en est qu'une fibre. Tout ce que vous ferez au tissu, vous le ferez à vous-mêmes.
Non, le jour et la nuit ne peuvent pas cohabiter.
Nos morts continuent à vivre dans les cours d'eau douce de la terre, ils reviennent avec le printemps, quand il s'approche à pas de loup, et leur âme souffle dans le vent qui ride la surface de l'étang.
Nous réfléchirons à la demande que nous fait l'homme blanc d'acheter notre pays. Mais mon peuple pose cette question : Que veut-il, l'homme blanc ? Comment peut-on acheter le ciel ou la chaleur de la terre — ou la vitesse de l'antilope ? Comment pouvons-nous vous vendre ces choses — et comment pouvez-vous les acheter ? Pouvez-vous donc faire tout ce que vous voulez de la terre — simplement parce que l'homme rouge signe un morceau de papier et le remet à l'homme blanc ?
Si nous ne possédons pas la fraîcheur de l'air et le miroitement de l'eau — comment pouvez-vous nous les acheter ? Pouvez-vous racheter les bisons, si le dernier bison a été tué ?
Nous réfléchirons à votre offre. Nous savons, si nous ne vendons pas, que l'homme blanc viendra sans doute avec des armes et s'emparera de notre pays. Mais nous sommes des sauvages.
L’homme blanc, qui possède passagèrement le pouvoir, croit déjà être Dieu, à qui appartient la terre.
Comment un homme peut-il posséder sa mère ?
Nous réfléchirons à votre offre d'acheter notre pays, le jour et la nuit ne peuvent pas cohabiter — nous réfléchirons à votre offre de nous installer dans la réserve. Nous vivrons à l'écart et en paix. Peu importe où nous passerons le reste de nos jours. Nos enfants ont vu leurs pères humiliés et vaincus. Nos guerriers ont été outragés. Après les défaites, ils passent leurs jours dans l'oisiveté — empoisonnent leur corps en avalant des aliments doux et des boissons fortes.
Peu importe où nous passerons le reste de nos jours. Il n'y en a plus beaucoup, de ces jours. Quelques heures encore, quelques hivers, et il ne restera plus un enfant des grandes tribus qui, jadis, vivaient dans ce pays et qui errent maintenant en petits groupes dans les forêts.
Plus un enfant pour pleurer sur les tombes d'un peuple qui, jadis, était aussi fort que le vôtre, et plein d'espérance comme vous ! Mais pourquoi devrais-je m'affliger du déclin de mon peuple ? Les peuples sont faits d'êtres humains — de rien d'autre.
Les êtres humains viennent et disparaissent comme les vagues de la mer.
Même l'homme blanc que son Dieu accompagne, ce Dieu qui lui parle comme à un ami, même l'homme blanc ne peut échapper à la destinée commune. Peut-être sommes-nous tout de même frères. Nous verrons.
Il est une chose que nous savons et que, peut-être, l'homme blanc ne découvrira que plus tard : notre Dieu est le même que le vôtre.
Vous croyez peut-être le posséder — tout comme vous cherchez à posséder notre pays — mais ceci, vous ne le pourrez pas. Il est le Dieu des hommes — le Dieu des Rouges comme celui des Blancs. Ce pays, pour lui, est précieux, et blesser la terre, c'est mépriser son créateur.
Les Blancs disparaîtront, eux aussi, peut-être plus tôt que toutes les autres tribus.
Continuez à infecter votre lit, et une nuit, vous mourrez étouffés par vos propres détritus. Mais en disparaissant, vous rayonnerez d'un magnifique éclat — animés par la force du Dieu qui vous a amenés dans ce pays et vous a destinés à régner sur ce pays et sur l'homme rouge.
Cette destination est pour nous une énigme. Quand les bisons seront tous massacrés, les chevaux sauvages réduits, quand les endroits retirés et mystérieux des forêts seront lourds de l'odeur des foules, quand l'image des champs mûrs sur les collines sera profanée par des fils parlants — où est le fourré ? disparu — où est l'aigle ? disparu.
Et s'il faut dire adieu au poney rapide et à la chasse, cela signifie quoi ?
La fin de la vie — et le début de la survie.
Dieu vous a donné d'exercer votre pouvoir sur les animaux, sur les forêts et sur l'homme rouge, pour une raison particulière — mais cette raison est pour nous une énigme. Peut-être pourrions-nous la comprendre si nous savions à quoi rêve l'homme blanc, quels sont les espoirs qu'il dépeint à ses enfants au cours des longues soirées d'hiver, et quelles sont les visions qu'il projette dans leurs pensées, afin qu'ils aspirent à un lendemain. Mais nous sommes des sauvages — les rêves de l'homme blanc nous restent cachés. Et parce qu'ils nous restent cachés, nous irons notre propre chemin. Car nous apprécions avant tout le droit que possède tout être humain de vivre comme il le désire —quelle que soit sa dissemblance avec ses frères.
Bien peu de choses nous unissent.
Nous réfléchirons à votre offre. Si nous acceptons, ce sera pour assurer la réserve que vous nous avez promise. Peut-être pourrons-nous y vivre à notre manière le peu de jours qui nous restent à vivre.
Quand le dernier homme rouge aura quitté cette terre et que son souvenir ne sera plus que l'ombre d'un nuage au-dessus de la prairie, l'esprit de mes pères restera vivant dans ces rivages et dans ces bois. Car ils ont aimé cette terre, comme le nouveau-né aime le battement du cœur de sa mère.
Si nous vous vendons ce pays, aimez-le comme nous l'avons aimé, souciez-vous-en comme nous nous en sommes souciés, gardez le souvenir du pays tel qu'il sera quand vous le prendrez. Et de toute votre force, de tout votre esprit, de tout votre cœur, conservez-le pour vos enfants et aimez-le comme Dieu nous aime tous.
Car il est une chose que nous savons : notre Dieu est le même Dieu que le vôtre. Cette terre est sacrée pour lui. Même l'homme blanc ne peut échapper à la destinée commune. Peut-être sommes-nous tout de même frères.
Nous verrons.
Grand chef Seattle.
Omar Aktouf, La stratégie de l’autruche, Post-mondialisation, management et rationalité économique, pages 136 à 143
La véritable signification de ce qui se passait lors de ces authentiques joutes oratoires ne m'effleura que plusieurs décennies plus tard, à l'occasion d'un colloque à l'Université d'Istanbul en 1989. C'est là, au cours de shoppings collectifs à travers l'inénarrable Bazar de cette vénérable cité que le sens — je pense originel — du marchandage me frappa.
Bien que je n'aie parlé qu'anglais, comme mes collègues américains ou européens, il m'était systématiquement réclamé par les marchands turcs, pour les mêmes produits, un prix au moins deux fois inférieur à celui exigé de mes compagnons, n'ayant pas comme moi une « tête de Turc » !
Il me revint alors, lorsque j'essayai d'analyser la signification de cette différence de traitement, que dans les souks nord-africains de mon enfance, le prix demandé par le marchand était (lorsque l'acheteur n'était pas un « ennemi », un membre du clan ou de la famille élargie du vendeur) systématiquement fonction du pouvoir d'achat qu'il attribuait au client.
Je compris donc à Istanbul, ce souvenir aidant, que la logique de « formation des prix » — dans le Bazar comme dans les souks — était, sinon totalement du moins en bonne partie, une logique d'adéquation entre pouvoir d'achat attribué au futur acheteur et prix consenti pour le produit convoité. Une sorte de logique « Robin des Bois » serait ainsi en jeu dans l'essence même du marchandage, car le plus riche paiera plus pour que le plus pauvre puisse se procurer le minimum vital.
Ainsi il y a en quelque sorte trois ajustements concomitants qui s'effectuent :
1. un ajustement entre pouvoir d'achat et prix négocié ;
2. un ajustement entre capacité de payement et satisfaction des besoins du plus grand nombre (les plus nantis payant un peu plus pour que les plus démunis puissent payer moins) ;
3. un ajustement entre valeur d'échange (du côté du marchand) et valeur d'usage (du côté de l'acheteur), autant au niveau individuel qu'interindividuel et collectif.
Sans compter, bien sûr, que le marchandage est aussi une pratique ancestrale de socialisation, une survivance millénaire de ce que le mot commerce signifie d'abord : une relation sociale ; un jeu d'habileté oratoire, parfois une joute poétique, et aussi et toujours, un véritable spectacle auquel chacun peut assister, et participer s'il le désire.
Dans les souks de mon enfance, gagnait un marchandage celui qui, par exemple, faisait rire l'autre le premier, ou celui qui, au jugement des témoins alentour, avait fait une réplique particulièrement spirituelle ou astucieuse. Il existait en outre de véritables vedettes, artistes du marchandage connus et reconnus, qui attiraient les foules autant qu'ils étaient redoutés des marchands. Ils servaient volontiers de « soutien » au marchandage de bien des clients, ou même, parfois, marchandaient à leur place.
On se rend donc au souk autant pour commercer, acheter et vendre que pour marchander et assister au spectacle du marchandage des autres.
Par ailleurs, le notable ou le riche perdaient lamentablement la face s'ils osaient « commercer » en deçà du niveau qui sied à leur rang. Et je me souviens que les prix demandés aux personnes connues pour être nanties étaient quasi systématiquement plus élevés que ceux demandés aux plus démunis. (Ce qui n'excluait nullement, envers les uns ou les autres, des offres de « dons » purs et simples de la part du marchand, ou le recours, de la part de ce dernier — comme c'est encore souvent le cas aujourd'hui en Afrique du Nord —, à des formules du genre « donnez ce que vous pouvez » ou, littéralement, « ce que souhaite votre bon vouloir » — en arabe, alli bgha el kahter, formule qui risquait de mettre le riche dans l'embarras s'il se mettait à jouer — publiquement — les pingres !)
Ainsi un marchand se voyait souvent répondre par un client jugeant le prix (ou plutôt faisant mine de le juger) exorbitant : « Me prends-tu pour un pacha ? », ou après la Seconde Guerre mondiale : « Me prends-tu pour un Américain ? »
Pour ne pas risquer de perdre la face, il ne viendrait jamais à l'idée d'un notable ou d'un nanti de proposer, en contrepartie du prix annoncé, un prix qui le ferait passer pour mesquin, qui risquerait de lui faire perdre la face. Il convient de toujours équilibrer rang socio-économique et contre-proposition.
On voit donc que le marchandage (là où il se pratique encore) est l'objet d'un immense malentendu interculturel, car pour l'Occidental en général, il s'agit d'un exercice devant conduire à « faire une bonne affaire », c'est-à-dire d'une sorte de lutte où le vainqueur sera celui qui aura imposé à l'autre son prix. « Bonne affaire » est alors synonyme de quelque chose comme « obtenir, dans une transaction, une plus grande quantité de satisfaction que l'autre ». À la limite, cela confine à chercher à duper l'autre, à exploiter tout rapport de force, toute position de faiblesse pour réaliser un gain à ses dépens.
Omar Aktouf, La stratégie de l’autruche, Post-mondialisation, management et rationalité économique, pages 147 à 149
Le marché de la théorie de la concurrence est un monde où les individus ont la liberté des rouages dans la mécanique de l'horloge. René Passet
Les déchets, la transformation des forêts en latérite, les bidonvilles, la mercantilisation de l'air, de l'eau et des gaz à effet de serre […] sont des créations de richesses. Bernard Maris
Omar Aktouf, La stratégie de l’autruche, Post-mondialisation, management et rationalité économique, page 161
Quand le profit ne s'obtient pratiquement plus qu'en générant chômage, exclusion, pollution, et qu'en recourant à des échappatoires fiscales, à des manipulations spéculatives, à des mégafusions entre géants qui reconstituent des empires financiers dépassant les PNB de nombre de pays (ce qu'on n'avait pas revu depuis les titans du début du siècle réduits par la loi américaine antitrust, comme l'empire pétrolier Rockefeller), c'est le début de la fin du capital traditionnel qu'il convient d'y voir et non pas le simple signal de recourir à de nouvelles recettes managériales et stratégiques.
Le saut, car saut il faudra, doit dès lors être conçu non plus en termes de degré mais de nature. Ce ne sont plus les modalités et les recettes qu'il faut changer, mais les fondements des rapports entre le capital d'un côté, le travail et la nature de l'autre. C'est à un changement radical des façons de raisonner à propos de l'économie, des organisations et de la gestion (et donc des façons de concevoir, conduire, vivre les rapports de production et de travail) qu'il faut songer d'urgence.
Omar Aktouf, La stratégie de l’autruche, Post-mondialisation, management et rationalité économique, pages 175 et 176
On entend plus parler que d'économie. Si au moins l'économisme ambiant — cette subordination d'à peu près toutes les sphères de la vie humaine à la logique comptable — soulageait la misère et les inégalités, on pourrait considérer la déshumanisation qui en résulte comme un moindre mal, une sorte de prix à payer. Mais on observe le contraire. Le discours économique dominant cautionne plutôt l'enrichissement des riches et l'appauvrissement des pauvres. Piètre caution d'ailleurs, puisque la science économique n'est qu'une sorte d'astrologie revue et corrigée par une caste sélecte de nouveaux gourous jaloux de leur pouvoir. N'êtes-vous pas fatigués de vous faire rouler par les économistes ? C'est un économiste qui vous le demande (1).
(1) Richard Langlois, Pour en finir avec l'économisme, Montréal, Boréal, 1995.
Omar Aktouf, La stratégie de l’autruche, Post-mondialisation, management et rationalité économique, page 182
Depuis déjà plusieurs années, bien des autorités notables du management dénoncent de façon toujours plus véhémente ce qu'ils appellent la fuite des enseignements en gestion vers des abstractions et des sophistications, notamment économico-mathématiques, qui ont peu à voir avec les réalités des entreprises. Parallèlement, les dossiers qui se succèdent dans les magazines et la presse grand public expriment l'ampleur des déceptions suscitées par les hauts diplômés en management auprès de leurs employeurs.
Si on essaie de résumer l'essentiel des reproches adressés aux écoles de gestion et à leur « produit » privilégié, le MBA, leur plus gros péché serait de se vouloir très savants, de chercher à rendre toujours plus scientifique un domaine où l'expérience pratique, le bon sens, l'intuition, le souci du concret, la qualité de la relation à l'autre sont bien plus déterminants que la maîtrise des modèles statistiques et des calculs abscons et sophistiqués, lesquels constituent une véritable fuite en avant dans le remplacement du réel par le discours abstrait sur le réel.
C'est dans ce contexte qu'une des autorités les plus en vue de ces dernières années, Henry Mintzberg, a pu écrire qu'il fallait former des managers et non des MBA. Il déplore que ces derniers aient acquis une sorte de droit à être immédiatement nommés à des postes de leaders, en dépit de leur manque de connaissances pratiques et d'expérience, tandis que celles et ceux qui ont été formés sur le terrain et savent ce que sont les réalités des organisations croupissent au plus bas de l'échelle du pouvoir (1).
Le manager ainsi formé en business school est le plus souvent un orfèvre de l'analyse théorique, un virtuose du calcul, un jongleur de modèles, mais un bien piètre gestionnaire du concret, du quotidien, du terrain, et un tout aussi piètre gestionnaire de ses rapports avec ses semblables (en particulier les employés). Ceux-ci, il n'a appris à les connaître et à les traiter qu'en termes de facteurs de production, de variables d'équations, d'inputs ou de ressources.
(1) Par comparaison, en Allemagne, un PDG sur trois ou quatre a commencé sa carrière au plus bas des échelons, souvent comme ouvrier ! Cf. l'enquête effectuée à ce sujet par M. Bauer et D. Bertin-Mourot : « Comment les entreprises françaises et allemandes sélectionnent-elles leurs dirigeants ? » Problèmes économiques, n° 2337, 11 août 1993, p. 14-19. Et au Japon (voir entre autres E. Vogel, Japan Number One ou D. Nora, L’Étreinte du Samouraï), il est procédé, le 1er avril de chaque année, à un recrutement généralisé, par exemple chez Toyota, où tout le monde commence au plus bas de l'échelle et où tous savent que leurs futurs chefs —jusqu'au plus haut niveau — seront des collègues entrés en même temps qu'eux : il n'y a jamais de nominations directes aux hauts postes ni de « parachutages » !
Omar Aktouf, La stratégie de l’autruche, Post-mondialisation, management et rationalité économique, pages 188 et 189
Intéressons-nous maintenant au vautour qui accompagne le Prométhée chrématistique : l'abandon progressif de la primauté de la valeur d'usage, au profit de la valeur d'échange. Pour assurer toujours plus l'orientation séculaire prise par le management dans son glissement inconditionnel vers la maximisation de la (seule) rentabilité financière (la chrématistique) on a sacrifié :
1. la qualité et la durabilité des produits et des services (en abaissant sans cesse les coûts, les temps de réalisation, en rognant sur les inspections de qualité, la sécurité, le respect de l'environnement, les effectifs) ;
2. la qualification du travail (ce dernier étant immanquablement considéré, dans l'optique chrématistique, comme l'un des principaux coûts dont l'entreprise doit se libérer, c'est de cela que procède ce que l'on nomme aujourd'hui l'employabilité, qui consiste en la qualification/formation minimale et immédiatement utile que doit assurer l'institution éducative, pour le service de l'entreprise) ;
3. la nature et le milieu de vie du vivant (ne peuvent être que « stock de ressources inépuisables » ; l'air, l'eau, les sols, que facteurs gratuits contaminables à merci ; les problèmes d'environnement, d'écologie, d'écosystèmes, que « coûts » supplémentaires et « agacements de rêveurs ») ;
4. l'emploi (qui, comme on l'a vu lors des discussions a propos de la plus-value extra de Marx, devient collectivement et transnationalement un facteur à réduire systématiquement pour demeurer compétitif.
Omar Aktouf, La stratégie de l’autruche, Post-mondialisation, management et rationalité économique, page 195
Pour ce qui est des États-Unis et de leur économie, j'aimerais ici mettre le lecteur en garde contre les « effets d'annonce » qui les montrent sans cesse sous un jour favorable, même sous le coup des scandales financiers les plus énormes. Tout d'abord, malgré les euphémismes utilisés à ce sujet, les États-Unis sont bel et bien entrés en récession depuis le début de 2001 (ce qui était plus que prévisible à cause de l'énormité de la bulle de l'économie virtuelle). Cependant, on essaye toujours de nier les évidences en citant les taux de chômage, de croissance « insolemment favorables » de ce pays. Je rappelle que : 1. la croissance et le « miracle » américains doivent être pondérés par la misère et la non-croissance entretenues par les multinationales américaines dans le tiers-monde ; 2. le taux de chômage ne tient compte ni des populations carcérales (record mondial absolu, prisons devenues lucratifs business privés, un État comme le Texas comptant plus de prisonniers que la France, l'Allemagne et l'Italie réunies), ni des pseudo-emplois de type précaire, intérimaire, du chômage déguisé ; 3. l'aide directe de l'État entretient largement les profits des plus grosses entreprises (1) ; 4. la pollution industrielle y fait des ravages sans aucune commune mesure avec des pays comme la Suède, l'Allemagne et le Japon (cas les plus récents : la prolifération des micro-algues dans les États gros utilisateurs d'élevages industriels comme la Caroline du Nord, du moustique de la maladie du Nil dans le Nord-Est : résultat direct du réchauffement du climat car ce moustique n'a rien à faire à de telles latitudes nord, élévation constante des émissions de CO2 les États-Unis étant responsables de 25 % de celles-ci à l'échelle mondiale) ; 5. ce pays a été classé, par Amnistie Internationale en 1998, sur le même plan que la Chine et Cuba pour le non-respect des droits humains ; 6. son économie est, comme le dit Michel Chossudovsky (2) une véritable économie de rente au détriment de pays comme les Philippines, Haïti, Taiwan, le Mexique, en y sous-traitant à vil coût une bonne partie de la production de son économie ; 7. enfin, que, dans les mots d'Emmanuel Todd (3), « le monde a besoin de se répéter qu'il y a un miracle américain, car c'est le dernier, après la chute de l'Est, auquel on peut espérer se raccrocher, et on le fera à tout prix ».
(1) Voir le Time du 9 novembre 1998, « What Corporate Welfare Costs? », p. 30-50.
(2) M. Chossudovsky, Le Monde diplomatique, octobre 1999.
(3) Emmanuel Todd, L’illusion économique, op. cit.
Omar Aktouf, La stratégie de l’autruche, Post-mondialisation, management et rationalité économique, pages 198 et 199
Tout cela étant, proposons une comparaison plus formelle de certaines caractéristiques des capitalismes et des managements de type nippo-rhénan, d'une part, et de type anglo-saxon d'autre part, afin de mettre en lumière les options qui existent à l'intérieur même du système économique capitaliste.
Des deux types de capitalisme et de management qui dominent la planète, l'un est orienté vers la maximisation de la valeur d'échange à court terme, et fondé sur la pensée économique néoclassique et néolibérale, c'est-à-dire sur le dogme du marché libre et autorégulé. C'est le capitalisme « financier-spéculateur », dont le prototype est le capitalisme anglo-américain.
Le second, plus orienté vers la capitalisation de long terme et la maximisation de la valeur d'usage (ce qu'on appelle partout de ses vœux, sous le vocable « qualité totale »), est fondé sur une pensée économique qui doit davantage aux économistes classiques et à la notion de marché social, c'est-à-dire un marché non pas autorégulé mais guidé et surveillé par l'État, pour garantir un minimum de bien-être pour tous et pour préserver la nature. C'est le capitalisme « industriel-producteur », dont le prototype est le capitalisme nippo-rhénan. Ainsi que le montre clairement Michel Albert (1), le financement de l'économie y est de « type bancaire ». La spéculation de type « spéculateur-boursier » y est pour ainsi dire « structurellement » impossible, du fait de la limitation du paiement de dividendes au niveau de la valeur réelle des actifs et des performances de l'entreprise, et de l'accent mis sur les gains en capitalisation comme mode de rémunération des actions, plutôt que sur le profit maximal à court terme. Ce sont donc les investissements productifs, les efforts de maintien de l'emploi (considéré comme un « droit » socialement reconnu et non comme un « privilège » que chaque individu doit conquérir de haute lutte), de qualification du travail, de recherche et de développement, etc., qui deviennent sources de gains et d'avantages compétitifs, et non le gonflement de valeurs fictives basées sur les coupures sauvages (downsizings, désinvestissements, fusions et redéploiements synergiques), la pollution impunie et les manipulations financières.
Il en découle un management très différent du management traditionnellement lié au type néoclassique et néolibéral, américain : le capital y est considéré et traité comme un des facteurs de production parmi les autres, et non comme le seigneur et maître absolu. Ainsi, les trois facteurs de production — capital, travail et nature (sous la forme des ressources naturelles) — y sont conduits à se respecter et à chercher l'équilibre et l'harmonie entre eux. Cela se fait par voie de négociation permanente et par des jeux de contre-pouvoir, à travers des mécanismes de partage des décisions et de planification commune entre État, travailleurs, écologistes, entrepreneurs, représentants de la société civile...
La rémunération des facteurs (autrement dit, la répartition des richesses produites et le maintien de l'équilibre entre les trois facteurs de production : capital, travail, nature) n'y est pas scandaleusement en faveur du seul capital et l'État n'y est pas un comité de gestion au service du milieu des affaires.
(1) Michel Albert, op. cit.
Omar Aktouf, La stratégie de l’autruche, Post-mondialisation, management et rationalité économique, pages 199 et 200
En résumé, le modèle de développement basé sur l'extension de la « libre entreprise » et du « libre marché autorégulé » à l'ensemble de la planète ne rencontre pas seulement des difficultés d’application (l’aggravation des inégalités, etc.) que l'on pourrait surmonter par des ajustements techniques, il est purement illusoire et idéologique car il repose sur des postulats impossibles. Prétendant s'imposer envers et contre tous les signes concrets de son aberration, il conduit à l'aggravation exponentielle des problèmes en question.
Car si la « foi technologique » et les dogmes de l'économisme dominant relèvent du mythe et de l'idéologie, les lois de l'entropie et de la constance de l'énergie relèvent, elles, dura lex sed lex, de la pensée scientifique la mieux établie de nos jours.
Omar Aktouf, La stratégie de l’autruche, Post-mondialisation, management et rationalité économique, page 239
Il est fini, le temps où l'on pouvait croire la Terre capable de fournir en énergie la boulimie de croissance infinie pour tous ; comme doit finir la croyance que les « puissants » peuvent se passer des « faibles ». Car les faibles d'aujourd'hui, à défaut de constituer les marchés solvables qui fourniront les débouchés et les échanges de demain (ce que les japonais ont bien compris, qui ont travaillé à développer des marchés solvables dans leur périphérie), seront les fossoyeurs des pays aujourd'hui nantis, par l'inéluctable paupérisation généralisée que leur insolvabilité chronique et exponentielle entraînera, jusqu'au cœur des économies dites développées.
La coopération, la condamnation de la spéculation et le respect du rythme des flux d'énergie dans la nature — ne couper un arbre que lorsque la nature peut faire repousser le même arbre, dans les mêmes conditions, au même endroit, ne pêcher un poisson que lorsque... ne pomper un litre de pétrole que lorsque... —, voilà l'inévitable porte de sortie. C'est la troisième solution indésirable pour l'ordre de la maximisation infinie de la valeur d'échange. Indésirable car elle impliquerait, dans l'organisation de la production économique, trop de sacrifices inacceptables aux yeux de ceux qui en profitent. Et elle est — à ce titre — totalement contraire à l'idéologie de l'économie dominante et du management qui la sert.
Omar Aktouf, La stratégie de l’autruche, Post-mondialisation, management et rationalité économique, pages 248 et 249
VOILA BIEN une bonne quinzaine d'années que l'on nous rabat les oreilles avec la mondialisation et ce que l'analyse dominante nous présente comme son géniteur naturel, la crise mondiale, « crise » conçue comme une sorte de soudaine maladie de l'économie mondiale qui a frappé de paresse et de diminution de compétitivité une partie substantielle de notre planète. Soudain, bien des États sont devenus trop « providence », bien des pays se sont montrés trop « sociaux », bien des régimes se sont révélés vivant au-dessus de leurs moyens, tandis que bien des entreprises — surtout publiques —, sont apparues se comportant plus comme des vaches à lait que comme des entités économiques jouant pleinement leur rôle de « bonnes faiseuses d'argent maximum pour les rois actionnaires ». Ces deux termes, mondialisation et crise mondiale, à eux seuls ou combinés aux transcendantes lois du marché, justifient à peu près tout, désormais, depuis la démission des États (dénommée tantôt libéralisation, tantôt démocratisation, tantôt déréglementation) jusqu'aux comportements les plus barbares de la part de chefs d'entreprise ayant perdu tout sens de la mesure et de la décence, pour en arriver à traiter les humains en purs et simples appendices secondaires du maintien du profit, des dividendes et de la survie du capital.
De réingénieries en downsizings, de fusions en acquisitions, de privatisations en sous-traitances, chaque jour de véritables crimes contre l'humanité sont commis pour la sauvegarde du capital et d'un profit de plus en plus difficile à assurer sans jeter, un peu partout, des cohortes de travailleurs à la rue. On en est à accepter l'inacceptable, à tolérer l'intolérable.
Désormais, « la solution » ne semble résider que dans deux directions : d’un côté la mise au pas du facteur travail, trop exigeant, trop pointilleux sur ses « droits acquis », pas assez flexible, pas assez compétitif, pas assez bon marché, avec des syndiqués pas assez ouverts au partage avec les chômeurs (1), et d'un autre côté, le rappel à l'ordre de l'État, trop gourmand, pléthorique, trop débonnaire vis-à-vis de la population en général, trop porté sur la réglementation, pas assez compréhensif envers les impératifs du business, trop contrariant pour le libre marché, trop gaspilleur, pas assez efficace...
De leur côté, le capital et son complément obligé, le profit, sont, bien entendu, non seulement hors de cause, éternellement bienfaiteurs, mais tout à fait intouchables, non partageables.
Jusqu’à quand va-t-on rester victimes muettes de la plus meurtrière crise de réajustement de l'ordre du capital et du profit infini ? Milton Friedman aurait donc totalement et définitivement enterré Karl Marx ? Est-ce vraiment, comme le souhaitent des Fukuyama, la fin de l'histoire, rendant inutiles et scabreux tout interventionnisme et toute surveillance de l'entreprise capitaliste privée, pivot central de cette histoire achevée ?
(1) Une autre marque de cynisme à ce sujet : le porte-parole de la compagnie Bell Canada, interrogé sur le bien-fondé de la vente d'activités, de compressions..., à un moment où l'entreprise réalisait des rendements financiers quasi records (1999-2000), répondit que c'était la faute des travailleurs puisque les caisses de retraite représentent une partie des gros actionnaires de Bell et exigent, comme tout actionnaire sensé, des rendements maximaux. On croit rêver ! Voilà le travail coupable, encore, des taux de rendement attendus du capital, et de sa propre mise au chômage !
Omar Aktouf, La stratégie de l’autruche, Post-mondialisation, management et rationalité économique, pages 285 et 286
Il convient de dire d'entrée de jeu que le seul fait d'admettre qu'il y a une crise économique (crise du capital et, forcément, de ses propres structures et fonctionnement, puisque sa logique et son action dominent l'économie mondiale) à l'échelle planétaire est un aveu de taille. Car jusqu'à plus ample informé, seuls Marx, les marxistes et les néo-marxistes avaient explicitement insisté sur l'inéluctabilité de crises cycliques, tendancielles, structurelles et de plus en plus graves dans l'évolution du capitalisme. En dehors de quelques économistes non marxistes comme Schumpeter, Hobson, Veblen ou Galbraith, tous nous ont plutôt habitués à analyser les cahots du système économique en termes d'ajustements des lois du marché et de corrections d'équilibres dans un mouvement toujours ascendant de croissance infinie.
Omar Aktouf, La stratégie de l’autruche, Post-mondialisation, management et rationalité économique, page 288
Et voici que changent les solutions à la crise !
Si les coupables sont désormais les plus riches, la poignée de pays et de personnes qui accaparent une part immense de la richesse mondiale, alors la solution n'est plus de s'acharner sur la main-d'œuvre pour la rendre plus rentable et sur les États pour les rendre moins gaspilleurs , ni d'organiser partout l'économie spéculative ou économie casino, mais de déconcentrer le capital et de brider la spéculation et la libre circulation des capitaux, y compris et surtout ceux dits « volatiles », « à risques »...
Ce serait d'écouter Hobson et de redistribuer les capitaux de façon à permettre une capacité de consommation réelle dans l'économie réelle plus large à l'échelle mondiale ; et comme le dirait Keynes, de relancer et de soutenir une demande globale qui devra atteindre un niveau proportionnel à l'offre globale.
C'est là tout le contraire des politiques économiques préconisées par les néolibéraux et les monétaristes néo-conservateurs, comme l'admet d'ailleurs le président de la Banque mondiale lui-même lorsqu'il invite ses collègues du FMI, déjà depuis les débuts de 1999, à se soucier davantage des conséquences néfastes de leurs prescriptions d'ajustements économiques . Les acteurs clés du nouvel ordre économique mondial, en effet, n'en sont pas à une contradiction près. Ainsi, de l'aveu même de « personnalités internationales » bien-pensantes comme Henry Kissinger, Georges Soros, Jeremy Sachs, le président de la Banque mondiale et le directeur général du FMI eux-mêmes, si on avait exercé un minimum de contrôle sur les mouvements de capitaux, on aurait évité ou atténué les crises du Mexique, du Brésil, (cf. les comptes rendus des différentes déclarations qui ont été faites lors du forum de Davos, en février 1999) — ce qui n'empêche nullement ces gens de refuser d'envisager la mise en œuvre de mesures telles que la fameuse « taxe Tobin » par exemple, laquelle aurait été un pas très important en ce sens.
Omar Aktouf, La stratégie de l’autruche, Post-mondialisation, management et rationalité économique, pages 294 et 295
« La grandeur d'une civilisation se mesure à la façon dont elle traite les plus faibles. »
Jean Rostand
Omar Aktouf, La stratégie de l’autruche, Post-mondialisation, management et rationalité économique, page 297
Aux États-Unis et au Canada, le taux de contribution de l'entreprise privée à l'assiette fiscale, entre 1950 et 1994, a chuté d'environ 50 % à moins de 10 % ! À l'inverse, aujourd'hui, la contribution à cette assiette fiscale (selon Statistique Canada) des seuls contribuables-citoyens est de plus de 85 % ! Dans le même ordre d'idée, on doit se poser la question de savoir pourquoi au Canada (et au Québec) le contribuable travailleur-consommateur est quasiment aussi taxé que son équivalent allemand ou scandinave, tout en recevant infiniment moins de services (depuis l'éducation publique jusqu'aux crèches, en passant par les transports en commun, les subventions au logement, les congés payés, les congés parentaux, le financement de recyclages professionnels, la santé, le soutien aux familles et aux démunis). N'y a-t-il pas lieu de se poser la question : où passe donc l'argent de la taxation des particuliers ? Dans la subvention du business et des plus riches (1) ?
(1) Comme le suggère l'article de fond du Time, intitulé « What Corporate Welfare Costs » (automne 1998), ou encore l'ouvrage de Léo Paul Lauzon, Financements publics, profits privés.
Omar Aktouf, La stratégie de l’autruche, Post-mondialisation, management et rationalité économique, page 298


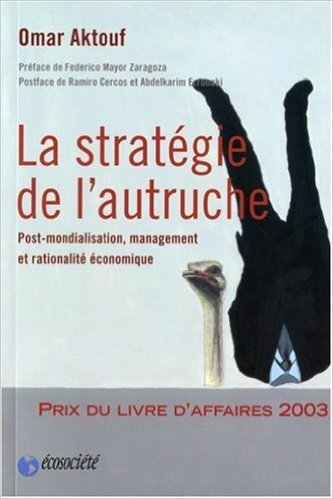


/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F82%2F77%2F1274499%2F133860676_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F85%2F42%2F1274499%2F132763947_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F07%2F06%2F1274499%2F132676602_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F35%2F55%2F1274499%2F124269003_o.jpg)