Noam Chomsky
Noam Chomsky est un linguiste et philosophe américain, professeur émérite au MIT. Il est le fondateur de la linguistique générative, et est aussi connu pour ses réflexions sur la politique américaine à l’intérieur comme à l’internationale. Il est reconnu comme l’un des plus grands intellectuels vivant aujourd’hui. Une référence pour ceux qui veulent mieux connaître le véritable fonctionnement du système politique.
Titre : Un monde complètement surréel
Auteur : Noam Chomsky
Genre : Géo-politique
Date : 1996
Pages : 48
Éditeur : ÉDAM
Collection : -
ISBN : 2-9803993-2-9
« Le contrôle idéologique est beaucoup plus important dans les démocraties que dans les États où la domination se fonde sur la violence, et il y est par conséquent plus raffiné et plus efficace.
Pour ceux qui recherchent obstinément la liberté, il ne peut y avoir de tâche plus urgente que d’arriver à comprendre les mécanismes et les méthodes de l’endoctrinement. Ce sont des choses faciles à saisir dans les sociétés totalitaires, mais elles le sont beaucoup moins dans le système de "lavage de cerveau sous régime de liberté" auquel nous sommes soumis et que nous servons trop souvent en tant qu’instruments consentants ou inconscients. »
Titre : Entretiens avec Chomsky
Auteur : David Barsamian
Genre : Politique / Géopolitique
Date : 1998
Pages : 170
Éditeur : Écosociété
Collection : -
ISBN : 2-921561-27-1
Les entretiens publiés dans ce livre nous permettent de découvrir Noam Chomsky dans l’intimité : un homme chaleureux, généreux, respectueux de tous, mais qui n’hésite jamais à rechercher partout la vérité et à la dire.
Au fil de ses réponses, il met à nu les structures de la société américaine organisée au profit d’une élite restreinte qui ne se contente pas d’exploiter la population de son pays, mais s’efforce d’étendre sa domination sur toute la planète.
D’un intérêt particulier, le point de vue de Chomsky sur le génocide au Timor Oriental et le rôle des États occidentaux dans cette affaire sans fin, spécialement celui de l’Australie.
David Barsamian, journaliste de renom, a eu plusieurs fois l’occasion d’interviewer Noam Chomsky au fil des ans. Ainsi les sujets couverts sont multiples.
Titre : La loi du plus fort, Mise au pas des États voyous
Auteur : Noam Chomsky, Ramsey Clark et Edward W. Said
Genre : Politique / Géopolitique
Date : 1999 (version orignale)
Pages : 115
Éditeur : Le Serpent à Plumes
Collection : Essais/Documents
ISBN : 2-84261-347-3
Nul n’est censé ignorer aujourd’hui le nom de Noam Chomsky, connu aussi bien pour ses travaux de linguiste – il est notamment l’inventeur de la grammaire transformationnelle – que pour son engagement contre la politique extérieure américaine, notamment à partir de la guerre du Vietnam. Chomsky est l’un de ces rares intellectuels dissidents à s’être préservé de l’embrigadement idéologique et à avoir lutté farouchement pour l’exigence d’objectivité. Sa défense inconditionnelle de la liberté de l’intellectuel vis-à-vis du pouvoir a même pu l’amener à commettre un faux pas, quand dans les années 1970 il s’est vu bien malgré lui (il n’avait pas lu, précisons-le, le texte du négationniste) l’otage de l’affaire Faurisson (on lira à ce sujet Deux heures de lucidité, récent entretien du savant publié aux Arènes).
Parallèlement à une série d’entretiens accordés peu après le 11 septembre (11/9 Autopsie des terrorismes), Le Serpent à Plumes publie, dans cette Loi du plus fort, un texte de Chomsky daté de 1998 et intitulé Les Etats voyous. Emboîtant le pas au critique Edward W. Said, Chomsky fait pièce à la vision manichéenne qui a cours dans l’administration américaine et selon laquelle les Etats « civilisés » (en tête desquels figureraient les Etats-Unis et l’Angleterre) auraient à charge de protéger le monde contre des « Etats voyous ». De quoi s’agit-il ? L’auteur explique qu’après la guerre froide et la chute de l’URSS, les enjeux économiques ont pris insensiblement le pas sur l’enjeu idéologique, quand bien même l’Amérique, par l’expression d’Etats voyous, s’efforcerait de déguiser l’égoïsme foncier qui meut sa politique.
Une rhétorique dont Chomsky dit tout le caractère opportuniste, rappelant au passage son caractère fluctuant - l’Irak remplaçant ainsi, au seuil des années 90, l’Iran et la Libye dans la liste incriminée. « Aux Etats-Unis, le mépris de la loi est profondément ancré dans la pratique et la culture intellectuelle. » Chomsky nous dresse le tableau accablant d’une politique extérieure américaine qui, plaidant au besoin la légitime défense, agit toujours « unilatéralement », jamais « multilatéralement ». Soutien systématique des dictateurs (Suharto en Indonésie, Saddam Hussein contre l'Iran, etc.) ; non-respect des décisions du Conseil de sécurité de L’ONU et notamment du très controversé article 51 (qui pose le principe de légitime défense de ses pays memebres); choix systématique de l’intervention militaire pour régler des crises ; procès truqués ; propagande visant à interdire aux citoyens ne serait-ce qu’une compréhension minimale de la réalité géopolitique : cette liste nous conduit rien moins qu’à l'effrayante notion de « culture du terrorisme » dont Chomsky faisait naguère le titre d’un de ses livres.
Thomas Regnier
Titre : Israël, Palestine, États-Unis : le triangle fatidique
Auteur : Noam Chomsky
Genre : Politique / Géopolitique
Date : 1999 (version orignale)
Pages : 653
Éditeur : Écosociété
Collection : -
ISBN : 2-923165-19-5
Le Triangle fatidique est peut-être l’ouvrage le plus ambitieux jamais écrit sur le rôle déterminant des États-Unis dans le conflit entre le sionisme et les Palestiniens. C’est un exposé tenace de la corruption, de l’avidité et de la malhonnêteté intellectuelle des humains. C’est également un grand livre et un livre important qui doit être lu par tous ceux qui se soucient de la chose publique.
– Extrait de la préface d’Edward W. Saïd
Enfin publiée en français, voici l’œuvre majeure de Noam Chomsky à propos de l’implication des États-Unis dans le conflit Israël-Palestine. En appuyant sa réflexion sur un travail de recherche colossal, toujours aussi rigoureux et complet, Chomsky démolit le récit officiel. Il s’attaque à toute une série de mythes: la démocratie israélienne, la bienveillance de l’occupation, l’absence de racisme contre les Arabes en Israël, le terrorisme palestinien, la paix pour la Galilée, etc., et les met en pièces avec un barrage de contre-exemples. Écrit à la manière ironique et impitoyable de Chomsky, voici le livre le mieux documenté pour expliquer cette crise qui semble insoluble.
Plus de 1100 sources documentaires dans ce livre, une véritable bible sur le sujet!
Titre : 11/9, Autopsie des terrorismes
Auteur : Noam Chomsky
Genre : Politique / Géopolitique
Date : 2001 (version orignale)
Pages : 154
Éditeur : Le Serpent à Plumes
Collection : -
ISBN : 2-84261-323-6
Les Etats-Unis mènent ce qu'on appelle une "guerre de faible intensité". C'est la doctrine officielle. Mais les définitions du conflit de faible intensité et celles du terrorisme sont presque semblables. Le terrorisme est l'utilisation de moyens coercitifs dirigés contre des populations civiles dans l'intention d'atteindre des visées politiques, religieuses ou autres. Le terrorisme n'est donc qu'une composante de l'action des Etats, c'est la doctrine officielle, et pas seulement celle des Etats-Unis. Aussi le terrorisme n'est-il pas, comme on le prétend souvent, "l'arme des faibles". Une première version de ce livre est parue en 2001 sous le titre 11/9 Autopsie des terrorismes. Dix ans après les attentats du 11-Septembre, une décennie de "guerre contre le terrorisme" aboutit à l'exécution de Ben Laden. Après avoir analysé le contexte historique international de ces attentats et en particulier le rôle des Etats-Unis, l'auteur discute, dans sa préface, de la politique étrangère américaine au regard des principes du procès de Nuremberg. Ce qui lui permet de soulever plusieurs questions : les interventions américaines (en Irak, en Afghanistan, etc.) ne doivent-elles pas être jugées comme un "crime international suprême" ? N'y a-t-il pas incompatibilité radicale entre toute justice internationale et le principe d'immunité que s'accordent les grandes puissances occidentales
Mon avis : Compilation d’interviews données dans les semaines qui suivent les attentats du 11 septembre 2001, elles révèlent une lucidité impressionnante qui prouve la parfaite maitrise du thème abordé malgré le recul inexistant que d’autres pourront avoir sans même atteindre ce pragmatisme, preuve que Noam Chomsky est un des plus grands intellectuels de notre époque. Le livre se lit bien et vite (il est court) même si certaines idées se répètent, cela n’alourdit pas le texte. A conseiller à tous ceux qui veulent une analyse concentré et qui n’ont pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture.
Titre : Dominer le monde ou sauver la planète? L’Amérique en quête d’hégémonie mondiale
Auteur : Noam Chomsky
Genre : Géo-politique
Date : 2003
Pages : 326
Éditeur : Fayard
Collection : -
ISBN : 978-2-213-61933-0
La politique actuelle de l'administration Bush sur la scène mondiale constitue-t-elle une rupture avec la position traditionnelle des États-Unis ? Pour Noam Chomsky - qui signe là son premier grand essai depuis une quinzaine d'années -, la Stratégie de sécurité nationale adoptée en 2002, dont le but avoué est de perpétuer indéfiniment la domination des États-Unis en empêchant l'émergence de tout rival, a eu de nombreux précédents dans la pratique des administrations passées, tant républicaines que démocrates. Ce qui est vraiment nouveau, c'est que cette attitude n'est plus déniée mais revendiquée ouvertement. En s'appuyant sur un travail de recherche ordre et sur l'exploitation de nombreuses archives récemment déclassifiées (dont les soviétiques), Chomsky analyse, avec autant d'indignation que d'humour, le discours du projet américain, dont il souligne très efficacement l'illogisme et l'injustice. II pose aussi une question essentielle : où nous mène une telle volonté d'hégémonie ? Sa réponse : à une situation d'extrême danger pour l'espèce humaine - du fait du réchauffement de la planète mais aussi de l'exacerbation du risque nucléaire. Hégémonie ou survie : tel est, selon Chomsky, le choix historique aujourd'hui, et nul ne sait quelle orientation va l'emporter.
Extraits :
Que le contrôle de l’opinion soit le fondement de tout gouvernement, du plus despotique au plus libre, on le sait au moins depuis David Hume, mais il convient d’ajouter à la formule une précision : il est infiniment plus important dans les sociétés libres, ou l’on ne peut maintenir l’obéissance par le fouet. Il est donc bien naturel que les institutions modernes de contrôle de la pensée – que l’on appelait très franchement « propagande » avant que le terme ne se démode en raison d’associations totalitaire – aient pris naissance dans les sociétés les plus libres. La Grande-Bretagne a été la pionnière en ce domaine, avec son ministère de l’Information qui a entrepris « de diriger la pensée de la plus grande partie du monde ». Et Wilson a vite suivi avec son Committee on Public Information. Ses succès dans la propagande ont inspiré les théoriciens de la démocratie progressiste et l’industrie moderne de la publicité. Des membres éminents du CPI, comme Walter Lippmann et Edward Bernays, ont puisé tout à fait ouvertement dans ces exploits du contrôle de la pensée, que Bernays appelait « l’ingénierie du consentement […], l’essence même du processus démocratique ». Le terme « propagande » est devenu une entrée dans l’Encyclopaedia Britannica en 1922, et dans l’Encyclopedia of Social Sciences dix ans plus tard, avec la caution scientifique de Harold Lasswell aux nouvelles techniques de contrôle de l’esprit public. Les méthodes des pionniers ont été particulièrement importantes, écrit Randal Marlin dans son histoire de la propagande, parce qu’elles ont été « largement imitées […] par l’Allemagne nazie, l’Afrique du Sud, l’Union soviétique et le Pentagone », bien que les prouesses de l’industrie des relations publiques les écrasent tous.
Randal Marlin, Propaganda and the Ethics of Persuasion, Peterborough (Ont.) et Orchard Park (NY), Broadview Press, 2002.
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, pages 15 et 16
Si l’exécutif a le pouvoir de jeter un homme en prison sans formuler contre lui aucune accusation reconnue par la loi, et en particulier s’il lui refuse le droit d’être jugé par ses pairs, on est au comble de l’odieux. C’est le fondement de tout régime totalitaire, qu’il soit nazi ou communiste.
Winston Churchill cité par A. W. Brian Simpson, Human Rights and the End of Empire : Britain and the Genesis of the European Convention, Oxford et New York, Oxford University Press, 2001, p.55.
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, page 43
Quand, sur des questions importantes pour l’élite, les Nations unies sortent du rôle d’ « instrument de l’unilatéralisme américain », elles ne comptent plus. Il en existe de nombreuses illustrations, dont le nombre record de veto. Depuis les années 1960, les États-Unis ont été, de très loin, les principaux utilisateurs du droit de veto au Conseil de sécurité sur une large gamme de problèmes, y compris contre des résolutions qui appelaient des États à respecter le droit international. La Grande-Bretagne est deuxième, la France et la Russie très loin derrière. Et même ce bilan déforme la réalité, car la puissance colossale de Washington impose souvent l’édulcoration des résolutions auxquelles il fait objection, ou interdit totalement l’inscription à l’ordre du jour de questions cruciales – comme les guerres qu’il a menées en Indochine, pour citer un exemple qui n’était pas un souci secondaire dans le monde.
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, pages 45 et 46
Certains commentateurs ont souligné qu’Israël détenait le record des violations. La Turquie et le Maroc, alliés des États-Unis, ont aussi violé davantage de résolutions du Conseil de sécurité que l’Irak. Celles-ci portaient sur des questions de la plus haute importance : agressions, méthodes dures et brutales dans le cadre d’une occupation militaire longue de plusieurs décennies, infractions graves aux conventions de Genève (ce sont des crimes de guerre en droit américain) et autres problèmes plus sérieux qu’un désarmement incomplet.
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, page 47
Nous ne croyons ni Bonaparte quand il dit se battre pour la seule liberté des mers, ni la Grande-Bretagne quand elle dit lutter pour la liberté de l’humanité. Ils ont le même but : aspirer à leur profit la puissance, la richesse et les ressources des autres pays.
Thomas Jefferson
Cité par l’historien mexicain José Fuentes Mares in Cecil Robinson (éd. et trad. angl.), The View from Chapultepec : Mexican Writers on the Mexican-American War, Tucson, University of Arizona Press, 1989, p.160.
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, page 71
La montée du fascisme dans l’entre-deux-guerres suscita des préoccupations, mais fut dans l’ensemble assez favorablement perçue par les gouvernements américain et britannique, le monde des affaires et une grande partie des élites. La raison : la version fasciste du nationalisme extrême autorisait une large pénétration économique occidentale, détruisait la gauche et le mouvement ouvrier (qui faisait très peur), ainsi que la démocratie excessive au sein de laquelle ils pouvaient agir. Mussolini fut soutenu avec ardeur. « Cet admirable gentleman italien », comme disait le président Roosevelt en 1933, a joui d’un grand respect dans des milieux d’opinions très diverses jusqu’à l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Ce soutien s’est étendu à l’Allemagne hitlérienne. Il est bon, soit dit en passant, de se souvenir que le régime le plus monstrueux de l’histoire est arrivé au pouvoir dans un pays qui pouvait raisonnablement passer pour la plus haute incarnation de la civilisation occidentale dans les sciences et les arts, et qu’on avait considéré comme une démocratie modèle avant que le conflit international n’ait pris des formes incompatibles avec cette formule (1). Un peu comme Saddam Hussein un demi-siècle plus tard, l’Allemagne a continué à jouir d’un important soutien anglo-américain jusqu’au jour où Hitler a lancé une agression directe qui empiétait trop sérieusement sur les intérêts des États-Unis et de la Grande-Bretagne.
Le soutien au fascisme s’est manifesté d’emblée. Dans le texte où il se félicite de la prise du pouvoir par les fascistes en Italie – qui sera vite suivie par l’abolition du parlementarisme et la répression violente de l’opposition syndicale et politique -, l’ambassadeur des États-Unis Henry Fletcher formule les postulats qui vont guider la politique américaine dans ce pays et ailleurs au cours des années suivantes. L’Italie, écrit-il au secrétaire d’État, était confrontée à un choix tranché : soit « Mussolini et le fascisme », soit « Giolitti et le socialisme » - Giolitti était une grande figure du libéralisme italien. Dix ans plus tard, en 1937, le département d’État considère toujours le fascisme européen comme une force modérée qui « doit absolument réussir, faute de quoi les masses populaires, avec le renfort, cette fois, des classes moyennes désillusionnées, vont à nouveau se tourner vers la gauche ». La même année, l’ambassadeur des États-Unis en Italie, William Philips, est « très impressionné par les efforts de Mussolini pour améliorer les conditions de vie des masses » et trouve « de nombreux faits concrets » à l’appui de la prétention des fascistes à « représenter une vraie démocratie, puisque le bien-être du peuple est leur objectif central ». Il juge les réalisations du Duce « stupéfiantes, source constante d’admiration », et vante avec enthousiasme ses « grandes qualités humaines ». Ce que confirme énergiquement le département d’État, qui lui aussi salue les résultats « magnifiques » de Mussolini en Éthiopie et félicite le fascisme d’avoir « fait jaillir l’ordre du chaos, la discipline de la licence et la solvabilité de la faillite ». En 1939, Roosevelt continue à considérer le fascisme italien comme « d’une grande portée pour le monde, [même s’il] reste au stade expérimental ».
En 1938, Roosevelt et son proche confident Sumner Welles approuvent les accords hitlériens de Munich qui démembrent la Tchécoslovaquie. Welles estimait, on l’a dit, qu’ils « offraient aux pays du monde l’occasion d’instaurer un nouvel ordre mondial fondé sur la justice et sur le droit », où les nazis, ces modérés, joueraient un rôle dirigeant. En avril 1941, George Kennan écrit du consulat de Berlin, où il est en poste, que les dirigeants du Reich ne souhaitent nullement « voir d’autres peuples souffrir sous la domination allemande », sont « très attentifs à ce que leurs nouveaux sujets soient heureux sous leur gouvernement », et font « d’importantes concessions » pour atteindre cet aimable résultat.
Le monde des affaires était, lui aussi, absolument enthousiasmé par le fascisme européen. D’où un boom de l’investissement en Italie fascisme. « Les Wops se déwopisent », écrivait la revue Fortune en 1934. Après l’accession de Hitler au pouvoir, un semblable boom de l’investissement s’est produit en Allemagne pour des raisons du même ordre : la menace des « masses » avait été contenue, et un climat de stabilité propice aux affaires s’était instauré. Jusqu’à l’éclatement de la guerre en 1939, écrit Scott Newton, la Grande-Bretagne était encore plus favorable à Hitler, pour des raisons profondément ancrées dans les relations industrielles, commerciales et financières anglo-allemandes et du fait d’une « politique d’autopréservation de l’establishment britannique » face à la montée des pressions populaires démocratiques.
Même après l’entrée des États-Unis dans le conflit, l’état d’esprit resta ambigu. En 1943, les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient commencé leurs efforts, qui devaient s’intensifier après la guerre, pour démanteler la résistance antifasciste dans le monde entier et restaurer une situation proche de l’ordre traditionnel, souvent en récompensant certains des pires criminels de guerre par des fonctions de premier plan. (2) « La base idéologique et les postulats fondamentaux de la politique américaine sont restés d’une remarquable constance » pendant les décennies suivantes, souligne Schmitz au vu des archives. La guerre froide « a exigé de nouvelles méthodes et tactiques », mais elle n’a rien changé aux priorités de l’entre-deux-guerres. (3)
Le « cadre théorique » que Schmitz illustre en détail s’est perpétué jusqu’à nos jours, au prix de souffrances et de dévastations immenses. Tout au long de ce parcours, les stratèges politiques ont été confrontés à un « problème déchirant » : concilier leur attachement formel à la démocratie et à la liberté et le fait primordial que « les États-Unis ont souvent besoin de faire des choses terribles pour avoir ce qu’ils ont toujours voulu », comme l’observe Alan Tonelson. Ce qu’ils ont toujours voulu, ce sont « des politiques économiques permettant aux entreprises américaines d’opérer de façon aussi libre et souvent aussi monopoliste que possible », afin de créer « une économie mondiale capitaliste intégrée, dominée par les États-Unis » (4).
(1) Ed Vulliamy, « Red Cross denied access to PoWs », Observer (Londres), 25 mai 2003, p.20
(2) Jack M. Balkin, « A dreadful act II : secret proposals in Ashcroft’s anti-terror war strike yet another blow at fundamental rights », Los Angeles Times, 13 février 2003, section B, p.23. Nat Hentoff, « Revenge of the Patriot Act », Progressive, vol. 67, numéro 4, avril 2003, p.11.
(3) Winston Churchill cite par A.W. Brian Simpson, Human Rights and the End of Empire : Britain and the Genesis of the European Convention, Oxford et New York, Oxford University Press, 2001, p.55
(4) C. Kaysen et al., War with Iraq, op. cit. Michael Krepon, « Dominators rule », Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 59, numéro 1, janvier-février 2003, p. 55-60
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, pages 94 à 97
La crise des missiles « a été le moment le plus dangereux de l’histoire de l’humanité », a déclaré Arthur Schlesinger en octobre 2002, lors d’une conférence organisée à La Havane pour le quarantième anniversaire des événements et à laquelle participaient un certain nombre de témoins qui les avaient vécus de l’intérieur. À l’époque, les responsables avaient incontestablement compris que le sort du monde était entre leurs mains. Néanmoins, pour ceux d’entre eux qui ont assisté à la conférence, certaines révélations ont été un choc. Ils ont appris qu’en octobre 1962 le monde était passé à « un mot » de la guerre nucléaire. « Un nommé Arkhipov a sauvé le monde », a déclaré Thomas Blanton, du service des archives de sécurité nationale de Washington, l’un des organisateurs de la conférence. Il parlait de Vassili Arkhipov, un officier de sous-marin soviétique qui, le 27 octobre, au plus fort de la crise, n’a pas exécuté l’ordre de lancer des torpilles à tête nucléaire alors que des destroyers américains attaquaient. Il est pratiquement certain que cet acte aurait entraîné une riposte dévastatrice, donc une guerre majeure. (1)
(1) Marion Lloyd, « Soviets close to using A-bomb in 1962 crisis, Forum is told », Boston Globe, 13 octobre 2002, section A, p. 20. Kevin Sullivan, « 40 years after missile crisis, players swap stories in Cuba », Washington Post, 13 octobre 2002, section A, p.28
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, page 104
[Au sujet de la crise des missiles de Cuba]
Kennedy n’avait aucun doute sur la menace des missiles russes à Cuba. « C’est exactement comme si nous nous mettions soudain à installer un grand nombre de [missiles balistiques de portée intermédiaire] en Turquie. […] Ce serait diablement dangereux », s’est-il exclamé lors d’une réunion avec ses plus hauts conseillers (ExComm (1)). « Mais nous l’avons fait, monsieur le Président », a répondu McGeorge Bundy, son conseiller à la Sécurité nationale. « Oui, mais c’était il y a cinq ans », a rétorqué Kennedy, surpris – en réalité, c’était un an plus tôt seulement, pendant son administration. Il s’en est ensuite inquiété : si les faits venaient à être connus, sa décision de risquer une guerre plutôt que d’accepter publiquement de coupler le retrait des missiles de Cuba et de Turquie ne serait pas très bien vue par l’opinion. Il craignait fort que la plupart des gens ne jugent un tel échange « tout à fait équitable ».
(1) Thomas G. Paterson, « Cuba and the missile crisis », in D. Merrill et T.G. Paterson (éd.), Major Problems, op. cit.
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, page 109 (f)
Terrorisme international et changement de régime : Cuba
La dictature Batista fut renversée par la guérilla de Castro en janvier 1959. En mars, le Conseil de sécurité nationale américain réfléchit aux moyens d’opérer un changement de régime. En mai, la CIA commença à armer des guérilleros à Cuba. « Durant l’hiver 1959-1960, il y eut une forte augmentation des raids aériens de bombardement et d’incendie supervisés par la CIA et effectués par des pilotes cubains » en exil aux États-Unis (1). Inutile d’épiloguer sur ce que feraient les États-Unis ou leurs clients dans une telle situation. Mais Cuba n’a pas réagi par des violences en territoire américain à des fins de représailles ou de dissuasion. Son gouvernement a préféré suivre la procédure prévue par le droit international. En juillet 1960, il a sollicité l’aide de l’ONU, remettant au Conseil de sécurité un dossier sur une vingtaine de bombardements, avec les noms des pilotes, les numéros d’immatriculation des avions, les bombes non explosées et d’autres détails précis. Le gouvernement cubain affirmait que ces raids avaient fait des dégâts considérables et de nombreuses victimes, et proposait de résoudre le conflit par des moyens diplomatiques. L’ambassadeur américain Henry Cabot Lodge répondit en donnant l’ « assurance [que] les États-Unis n’[avaient] aucune intention agressive contre Cuba ». Quatre mois plus tôt, en mars 1060, son gouvernement avait pris en secret la décision ferme et définitive de renverser le gouvernement Castro, et les préparatifs de la baie des Cochons étaient bien avancés. (2)
(1) Morris H. Morley, Imperial State and Revolution : The United States and Cuba, 1952-1986, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1987. Voir Daniele Ganser, Reckless Gamble : The Sabotage of the United Nations in the Cuban Conflict and the Missile Crisis of 1962, New Orleans, University Press of the South, 2000, et Stephen M. Streeter, Managing the Counterrevolution : The United States and Guatemala, 1954-1961, Athens (Ohio), Ohio University Center for International Studies, 2000
(2) « A program of covert action against the Castro regime », 16 mars 1960
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, pages 113 à 114
Aussi horrible et brutal qu’il ait pu être, le régime de Saddam Hussein a bel et bien orienté les profits du pétrole vers le développement intérieur. Ce « dictateur régnant sur un système qui a fait de la violence un moyen de gouvernement », à l’ « effroyable bilan en matière de droits de l’homme », a néanmoins « fait entrer dans la classe moyenne le moitié de la population du pays, et les Arabes du monde entier […] sont venus étudier dans les universités irakiennes » (1). La guerre de 1991, avec la destruction délibérée des réseaux d’adduction d’eau, d’électricité et d’égouts, a porté un coup terrible à l’Irak, et le régime de sanctions imposé par les États-Unis et la Grande-Bretagne l’a ramené au niveau de la simple survie (2). Illustration parmi d’autres : on lit dans le rapport 2003 de l’UNICEF sur la situation des enfants dans le monde que « la régression de l’Irak pendant les dix dernières années est de loin la plus grave des 193 pays étudiés »; le taux de mortalité infantile, « meilleur indicateur du bien-être des enfants », est passé de 50 à 133 pour 1000 naissances vivantes, ramenant l’Irak derrière tous les pays non africains à l’exception du Cambodge et de l’Afghanistan. Deux experts militaires proches des faucons observent que « les sanctions économiques ont peut-être été la cause nécessaire [sic] de plus de plus de morts en Irak que les armes dites de destruction massive n’ont fait de victimes dans toute l’histoire » - plusieurs centaines de milliers, suivant des estimations prudentes (3).
(1) Turi Munthe, « Introduction », in T. Munthe (éd.), The Saddam Hussein Reader, New York. Thunder’s Mouth, 2002, p.XXVII
(2) Techniquement, les sanctions ont été imposées par l’ONU, mais il a toujours été clair qu’elles étaient mises en œuvre par les États-Unis et la Grande-Bretagne sous l’égide de l’ONU, et sans grand soutien, en particulier pour celles qui visaient cruellement les populations civiles.
(3) Frances Williams, « Child death rate in Iraq trebles », Financial Times (Londres), 12 décembre 2002, section Économie internationale, p.9. John Mueller et Karl Mueller, « Sanctions of mass destruction », Foreign Affairs, vol. 78, numéro 3, mai-juin 1999
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, pages 177
Le « désintérêt affiché » pour les effets probables de la guerre sur la population du pays que l’on va envahir est traditionnel. On l’a encore constaté quand, cinq jours après le 11 septembre, Washington a demandé au Pakistan de mettre fin aux « convois de camions apportant à la population civile d’Afghanistan une bonne part de son approvisionnement en nourriture et en autres produits », provoqué le retrait du personnel humanitaire international et une réduction massive de l’aide alimentaire, laissant ainsi « des millions d’Afghans […] face à un risque grave de famine (1) » - que l’on aurait pu à bon droit qualifier de « génocide silencieux ». L’estimation du nombre de personnes exposées à un « risque grave de famine » est passée de 5 millions avant le 11 septembre à 7,5 millions un mois plus tard. La menace puis la réalité des bombardements ont suscité de vives protestations de la part des organisations humanitaires, qui ont mis en garde contre leurs conséquences possibles. Leurs propos n’ont retenu que sporadiquement et très partiellement l’attention, et éveillé fort peu de réaction.
(1) John F. Burns, « Pakistan antiterror support avoids vow of military aid », New York Times, 16 septembre 2001, section 1, p.5. Samina Ahmed, « The United States and terrorism in Southwest Asia : September 11 and beyond », International Security, vol.26, numero 3, hiver 2001-2002, p. 79-93
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, page 180
[Les États-Unis essaient de convaincre la Turquie d’embarquer dans la guerre en Irak]
Tandis que l’opinion publique devenait, semble-t-il, encore plus hostile à la guerre, le gouvernement finit par plier face aux graves mesures de coercition économiques et autres imposées par les États-Unis, et accepta de satisfaire les exigences de Washington malgré une opposition populaire « écrasante ». Un « diplomate occidental » - probablement de l’ambassade américaine – dit à la presse qu’il était « encouragé » par cette décision et la jugeait « très positive ». Le correspondant en Turquie Amberin Zaman précisa :
L’idée d’une guerre contre l’Irak reste extrêmement impopulaire chez les Turcs. C’est pourquoi, jeudi, le Parlement s’est réuni à huis clos et a voté à scrutin secret. Vendredi, tous les journaux affichaient des titres cinglants pour le Parti de la justice et du développement au pouvoir, telle la une du quotidien très respecté Radikal : « Le Parlement a fui le peuple ».
À la quasi-unanimité, les Turcs étaient opposés aux ordres de Washington, mais chacun comprenait que les gouvernants devaient obéir, et la Turquie rejoignit la Nouvelle Europe (1).
Du moins le crut-on. En définitive, les Turcs donnèrent une leçon de démocratie à l’Occident. Le Parlement finit par refuser son aval au plein déploiement des troupes américaines en Turquie. Pour formuler le résultat dans le cadre de la pensée admise :
La guerre terrestre a été gênée parce que la Turquie n’a pas accepté son rôle de pays d’accueil des forces du front nord, pour des raisons politiques là encore. Son gouvernement a été trop faible face au sentiment antiguerre (2).
Les présupposés sont limpides : les gouvernements forts se moquent de leur peuple et « acceptent le rôle » que leur assigne le maître du monde ; les gouvernements faibles cèdent à la volonté de 95% de leur population.
Le stratège du Pentagone Paul Wolfowitz a formulé clairement le point crucial. Lui aussi a réprimandé le gouvernement turc pour son inconduite, mais il a ensuite condamné l’armée. Elle n’a pas joué, a-t-il dit, « le rôle dirigeant fort que nous aurions attendu », mais a fait preuve de faiblesse en laissant le gouvernement respecter l’opinion publique quasi unanime. Il fallait donc à présent, selon lui, que la Turquie se lève et dise : « Nous avons fait une erreur. […] Voyons maintenant comment nous pouvons aider le mieux possible les Américains. » La position de Wolfowitz est particulièrement instructive parce qu’on voit en lui le grand visionnaire de la croisade pour démocratiser le Moyen-Orient (3).
(1) Dexter Filkins, « Turkish parliament is asked to approve US troops », New York Times, 26 février 2003, section A, p.10 ; D. Filkins, « Turkey backs United States plans for Iraq », New York Times, 6 février 2003, section A, p.17. Amberin Zaman, « Iraqi Kurds balk at Turks’s role », Los Angeles Times, 8 février 2003, section A, p.11.
(2) Steven R. Weisman, “Politics shapes the battlefield in Iraq”, New York Times, 30 mars 2003, section 4 (Revue de la semaine), p.3.
(3) Paul Wolfowitz cite in Marc Lacey, “Turkey rejects criticism by US official over Iraq”, New York Times, 8 mai 2003, section A, p.15.
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, pages 189 et 190
La désillusion à l’égard de la démocratie formelle s’est manifestée clairement aux États-Unis aussi, et elle s’est accentuée pendant la période néolibérale. Il y a eu beaucoup de bruit autour de l’« élection volée » de novembre 2000, et on s’est étonné que la chose n’ait guère intéressé les Américains. Des enquêtes d’opinion suggèrent les raisons probables de cette attitude : à la veille de l’élection, les trois quarts de la population la considéraient comme un jeu auquel participaient les gros contributeurs, les chefs de parti et l’industrie de la publicité, cette dernière amenant habilement les candidats à dire « presque n’importe quoi pour être élu ». Sur aucun sujet ou presque les citoyens ne pouvaient cerner les positions des candidats, ce qui était le but recherché. Les questions sur lesquelles la population a un autre avis que l’élite sont généralement exclues des programmes. Les électeurs sont orientés vers les « qualités personnelles », pas vers les « problèmes ». Dans un corps électoral lourdement déséquilibré en faveur des riches, ceux qui estiment que leurs intérêts de classe sont en jeu cherchent à les protéger, donc votent pour le plus réactionnaire des deux partis des milieux d’affaires. Mais le gros de l’électorat répartit ses voix autrement, ce qui parfois, comme en 2000, aboutit à l’égalité statistique. Dans les milieux ouvriers, des problèmes non économiques, tels que le droit de posséder une arme à feu et la « religiosité », ont joué un rôle essentiel, si bien que ces électeurs ont souvent voté contre leurs propres intérêts fondamentaux – en partant du constat, semble-t-il, qu’ils n’avaient guère le choix. En 2000, le sentiment d’« impuissance » a atteint son plus haut niveau mesuré : plus de 50% (1).
Ce qui reste de la démocratie, c’est essentiellement le droit de choisir entre des marchandises. Les dirigeants du monde des affaires expliquent depuis longtemps qu’il convient d’imposer à la population une « philosophie de la futilité », une « absence d’objectifs », afin de focaliser « l’attention des gens sur les choses les plus superficielles, qui répondent pour la plupart à des effets de mode » (2). Soumis depuis leur plus tendre enfance à un déluge de propagande de ce genre, les gens pourront accepter leur vie insignifiante et subordonnée, et oublier ces idées ridicules autour de la gestion collective de leurs affaires. Ils s’en remettront à des chefs d’entreprise et à l’industrie de la publicité, ainsi que, sur le plan politique, aux « minorités intelligentes » autoproclamées qui servent et administrent le pouvoir.
De ce point de vue, traditionnel dans la pensée de l’élite, les élections de novembre 2000 n’ont pas révélé un vice de la démocratie américaine mais plutôt son triomphe. Et, si l’on généralise, il est juste de saluer le triomphe de la démocratie dans tout l’hémisphère, et ailleurs, même si les populations ne le voient pas ainsi.
(1) Thomas E. Patterson, « Will democrats find victory in the ruins », Boston Globe, 15 décembre 2000, section A, p.27, et « Point of agreement : We’re glad it’s over », New York Times, 8 novembre 2000, section A, p.27. Voir aussi son livre The Vanishing Voter : Public Involvement in an Age of Uncertainty, New York, Alfred A. Knopf, 2002. Gary C. Jacobson, “A House and Senate divided : The Clinton legacy and the Congressional elections of 2000”, Political Science Quarterly, vol. 116, numéro 1, printemps 2001, p. 5-27.
(2) Stuart Ewen, Captains of Consciousness : Advertising and the Social Roots of the Consumer Culture, New York, McGraw-Hill, 1976, p.85 (trad, fr. de Gérard Lagneau, Consciences sous influences : publicité et genèse de la société de consommation, Paris, Aubier-Montaigne, 1983, p.92). Voir aussi Michael Dawson, The Consumer Trap : Big Business Marketing in American Life, Urbana (Ill), University of Illinois Press, 2003, pour une étude approfondie de la technique du “contrôle hors travail » élaborée à partir des années 1920 pour faire pendant à celle du « contrôle au travail » (le taylorisme), afin de transformer les gens en robots tenus en main dans la vie comme à l’entreprise.
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, pages 193 et 195
Depuis les années Reagan-Bush I (et même avant), Washington avait soutenu Saddam Hussein de diverses façons. Après son inconduite d’août 1990, les politiques et les prétextes ont varié, mais un principe est resté constant : il ne faut pas que le peuple irakien contrôle son pays. Faut-il le répéter ? On a laissé le dictateur réprimer le soulèvement de 1991 parce que – on nous l’a dit – Washington cherchait une junte militaire pour diriger le pays « avec une poigne de fer », et qu’à défaut d’autre candidat c’était à Saddam de le faire. Les insurgés ont échoué parce que « très peu de gens hors d’Irak souhaitaient qu’ils gagnent » - entendons que Washington et ses alliés locaux ne le souhaitaient pas, car il régnait chez eux un « point de vue d’une unanimité frappante » : « quels que fussent les péchés du dirigeant irakien, il offrait à l’Occident et à la région un meilleur espoir de stabilité dans son pays que ceux qui avaient subi sa répression ». Il est impressionnant de voir avec quelle uniformité cet aspect des choses a été refoulé dans les reportages et commentaires indignés sur la mise au jour des immenses fosses communes où avaient été enterrées les victimes tombées lors de ce paroxysme de la terreur de Saddam Hussein autorisé par les États-Unis. On a même voulu se servir de cette découverte pour justifier la guerre récente « sur des bases morales », maintenant que nous avions vu « les fosses communes et la vraie dimension de l’abomination génocidaire de Saddam » - dont nous avions été immédiatement informés en 1991, mais que nous avions laissées se déployer en raison de l’impératif de « stabilité ». (1)
Le soulèvement aurait laissé le pays entre les mains d’Irakiens qui auraient peut-être été indépendants de Washington. Les sanctions des années suivantes ont compromis la possibilité même de voir se produire le type de révolte populaire qui a renversé d’autres monstres, aussi fermement soutenus par les dirigeants américains actuels. Les États-Unis ont cherché à monter des coups d’État avec des groupes qu’ils contrôlaient, mais une révolte populaire ne les aurait pas mis aux commandes. Lors du sommet des Açores en mars 2003, Bush a réitéré cette position, déclarant que les États-Unis envahiraient l’Irak même si Saddam et ses complices quittaient le pays. […] Les décideurs politiques américains vont sans nul doute essayer de mettre en œuvre leur pratique constante ailleurs : la démocratie formelle, c’est bien, mais seulement si elle obéit aux ordres, comme la Nouvelle Europe, ou si elle prend la forme des démocraties « restreintes et verticales » d’Amérique latine, gouvernées par « les structures de pouvoir traditionnelles auxquelles les États-Unis [sont] alliés de longue date » (Carothers). Brent Scowcroft, conseiller à la Sécurité nationale de Bush I, a parlé pour les modérés en observant : s’il y a des élections en Irak et que « les radicaux gagnent […], nous n’allons sûrement pas les laisser prendre le pouvoir » (2). Par exemple, si les chiites majoritaires jouent un rôle important dans l’Irak de l’après-Saddam et, avec d’autres dans la région, s’efforcent d’améliorer les relations avec l’Iran, ce seront des « radicaux » et ils seront traités comme tels. Et il ne faut pas s’attendre à autre chose – sauf si nous décidons que l’histoire ne compte pas – si les élections sont gagnées par des démocrates laïques qui se révéleraient eux aussi « radicaux ».
(1) T.L Friedman, « NATO tries to ease security concerns in Eastern Europe », art. Cite. Alan Cowell, “Kurds assert few outside Iraq wanted them to win”, New York Times, 11 avril 1991, section A, p.11. Thomas L. Friedman, “Because we could”, New York Times, 4 juin 2003, section A, p.31
(2) Brent Scowcroft cite in Bob Herbert, “Spoils of war”, New York Times, 10 avril 2003, section A, p.27
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, pages 219 et 220
[Les relations États-Unis-Israël : origines et maturation]
Inutile d’être un fin connaisseur des affaires du monde pour prédire que le chaudron de colères du Moyen-Orient va continuer à bouillir. Le passage du monde industriel, à partir de la Première Guerre mondiale, à une économie fondée sur le pétrole et la découverte des incomparables gisements pétroliers moyen-orientaux ont exacerbé les conflits internes de la région. Après la Seconde Guerre mondiale, l’une des grandes priorités de la politique américaine a été d’assurer la mainmise des États-Unis sur cette zone si riche en ressources et si importante stratégiquement.
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, page 222
Israël comprit immédiatement que, l’hypothèse de la dissuasion arabe étant levée, il pouvait intensifier son expansion dans les territoires occupés et attaquer son voisin du nord, ce qu’il fit en 1978 et en 1982, après quoi il occupa des territoires libanais pendant près de vingt ans. L’invasion de 1982 et ses lendemains immédiats ont fait environ 20 000 morts; selon les sources libanaises, les pertes humaines dans les années suivantes se sont montées à 25 000 morts environs. Le sujet n’intéresse guère en Occident, en vertu d’un principe connu : il n’est pas besoin d’enquêter sur les crimes dont nous sommes responsables, et encore moins de punir les auteurs ou d’indemniser les victimes.
De multiples bombardements et autres provocations n’ayant pas suffi à créer un prétexte pour l’invasion prévue en 1982, Israël saisit finalement celui d’une tentative d’assassinat de son ambassadeur à Londres par le groupe terroriste d’Abou Nidal, qui avait été condamné à mort par l’OLP et lui faisait la guerre depuis des années. L’opinion américaine informée jugea ce motif acceptable, et ne vit aucun problème dans la riposte instantanée d’Israël : une attaque contre les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Chatila à Beyrouth, qui fit 200 morts, selon un observateur américain fiable (1). Les tentatives des Nations unies pour arrêter l’agression furent bloquées par des veto américains immédiats. Tout cela se poursuivit donc : dix-huit années sanglantes d’atrocités israéliennes au Liban, rarement justifiées ne serait-ce que par un semblant de prétexte d’auto-défense (2).
(1) On trouvera dans mon livre Fateful Triangle, op. cit., un récit des événements et la façon dont les médias et les commentateurs y ont réagi.
(2) Sur l’action d’Israël au Liban dans les années 1980 et 1990, voir mes livres Pirates et Empereurs, op. cit., et Fateful Triangle, éd. mise à jour, op. cit.
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, page 231
Sur le front diplomatique, vers le milieu des années 1970, l’isolement des États-Unis et d’Israël s’est accru avec l’inscription du problème palestinien à l’ordre du jour des institutions internationales. En 1976, les Américains ont opposé leur veto à une résolution qui, en reprenant la formulation fondamentale de la résolution 242 de 1967, appelait à la création d’un État palestinien au côté d’Israël. À partir de cette date et jusqu’à aujourd’hui, les États-Unis ont bloqué toute possibilité de règlement diplomatique sur la base acceptée par la quasi-totalité de la planète : deux États délimités par la frontière internationale avec des « ajustements mineurs et mutuels »; c’était aussi en principe, mais non en réalité, la position américaine officielle, jusqu’au jour où l’administration Clinton a abandonné ouvertement le cadre de la diplomatie internationale en déclarant les résolutions de l’ONU « obsolètes et anachroniques ». Notons bien que cette attitude n’est pas celle de la grande majorité de la population des États-Unis. L’opinion américaine soutient le « plan saoudien », proposé début 2002 et accepté par la Ligue arabe, qui offre une reconnaissance et une intégration totale d’Israël dans la région en échange de son retrait sur ses frontières de 1967 – nouvelle variante du consensus international établi de longue date mais paralysé par les États-Unis. De larges majorités estiment aussi que les États-Unis doivent égaliser l’aide à Israël et celle accordée aux Palestiniens dans le cadre d’un règlement négocié, et qu’ils doivent suspendre l’aide à toute partie refusant de négocier – ce qui voulait dire, à la date du sondage, l’aide à Israël. Mais peu d’Américains comprennent ce que tout cela signifie, et les médias ne leur expliquent pratiquement rien (1).
(1) Mark Sappenfield, « Americans, Europeans differ on Mideast sympathies”, Christian Science Monitor, 15 avril 2002, p.1. Program on International Policy Attitudes (PIPA), Americans on the Israel-Palestinian Conflict, College Park (Md.), University of Maryland, 8 mai 2002.
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, pages 232 et 233
Déclaration des hautes parties contractantes à la IVème convention de Genève (rapport sur la colonisation israélienne élaboré lors d’une conférence sur l’application du droit humanitaire international dans les territoires palestiniens occupés, Genève, Suisse, 15 décembre 2001).
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, note 40, page 245
Selon la comptabilité des Forces de défense, le rapport entre morts palestiniens et morts israéliens a presque atteint 20 pour 1 le premier mois de l’Intifada (75 Palestiniens, 4 israéliens), sur un territoire occupé militairement et où la résistance n’allait guère au-delà des jets de pierres. Les énormes bulldozers de l’armée, fournis par les États-Unis, sont aussi entrés en action pour détruire des habitations, des champs, des oliveraies, des forêts, en toute désinvolture, conformément aux méthodes qui, se désole un correspondant, ont fait d’Israël « un synonyme de bulldozer » - à l’inverse de l’idéal fondateur, « faire fleurir le désert ». (1)
Dès le début, Israël a utilisé des hélicoptères militaires américains pour attaquer des cibles civiles, tuant et blessant des dizaines de personnes. Clinton a aussitôt réagi – par le plus gros contrat de vente d’hélicoptères militaires depuis dix ans. Sans condition restrictive sur leur usage, a précisé le Pentagone à la presse. Les faits, immédiatement connus, ont été passés sous silence aux États-Unis.
B. Kaspit, « Shnatayim la-Intifada », art. cité. Doron Rosenblum, « Our friend the Bulldozer”, Ha’aretz, 26 septembre 2002.
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, page 250
Pour illustrer l’impact des leçons dégrisantes de la Seconde Guerre mondiale, rappelons qu’au Kenya, dans les années 1950, la répression par la Grande-Bretagne d’une révolte anticoloniale a fait 150 000 morts – une campagne militaire faite de terreur et d’atrocités effroyables mais inspirée, comme toujours, par les plus nobles idéaux. Le gouvernement britannique avait expliqué au peuple kenyan en 1946 que la Grande-Bretagne détenait ses terres et ses ressources naturelles « de droit, à la suite d’événements historiques qui reflètent la plus grande gloire de nos pères et de nos grands-pères ». Si « la majorité des richesses du pays sont à présent entre nos mains », c’est parce que « cette terre que nous avons faite est à nous de droit – le droit des réalisations », et les Africains doivent simplement apprendre à vivre dans « un monde que nous avons fait, mus par l’élan humanitaire de la fin du XIXème siècle et du XXème siècle » (1)
(1) M. Curtis, Web of Deceit, op. cit., chap.15
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, page 253
En décembre 1982, après un débordement de terrorisme et d’atrocités de la part des colons et des Forces de défense dans les territoires – débordement qui choqua même des faucons en Israël -, un éminent spécialiste universitaire israélien des questions militaires a souligné les risques, pour la société israélienne, d’une situation où 750 000 jeunes qui ont servi dans les Forces de défense « savent que la tâche de l’armée n’est pas seulement de défendre l’État sur le champ de bataille contre une armée étrangère, mais aussi de priver de leurs droits des innocents pour l’unique raison que ce sont les Araboushim vivant dans des territoires que Dieu nous a promis ». Le principe de base avait été formulé dans les premières années de l’occupation par Moshe Dayan. Israël, avait-il suggéré, devait dire aux Palestiniens des territoires : « « Nous n’avons pas de solution. Vous continuerez à vivre comme des chiens, et tous ceux qui veulent s’en aller peuvent le faire. » Et nous verrons bien où cela nous mènera (1). » Mais les Palestiniens sont restés, en samidin (ceux qui résistent en endurant), subissant et ripostant peu. Avec la seconde Intifada, ce fut différent. Cette fois, les ordres d’écraser implacablement les Palestiniens et de leur apprendre « à ne pas relever la tête » ont déclenché une escalade de la violence, et elle a débordé en Israël, qui a perdu l’importante immunité aux représailles venues de l’intérieur des territoires dont il bénéficiait depuis plus de trente ans d’occupation militaire.
(1) Yoram Peri, Davar, 10 décembre 1982. Araboushim est un terme d’argot israélien, à peu près l’équivalent de négros ou youpins. Moshe Dayan, débat interne du gouvernement , cité in Yossi Beilin, Mehiro shel Ilhud (en hébreu), Israël, Revivim, 1985, p.42
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, page 254
[Au sujet du terrorisme]
Il existe des définitions officielles de l’État américain, et elles sont aussi claires que pour d’autres expressions qui ne font pas problème. Selon un manuel de l’armée de terre des États-Unis, le terrorisme est « l’usage délibéré de la violence, ou de la menace de la violence, pour atteindre des objectifs de nature politique, religieuse ou idéologique […] par l’intimidation ou la contrainte, ou en inspirant la peur ». Le code officiel des États-Unis (1) propose une définition plus précise, mais fondamentalement semblable. Celle de l’État britannique est aussi très proche : « Le terrorisme est le recours, ou la menace de recourir, à une action violente, nocive ou perturbante, afin d’influencer le gouvernement ou d’intimider la population pour promouvoir une cause politique, religieuse ou idéologique » (2). Ces définitions semblent tout à fait claires. Elles sont fort peu éloignées de l’usage courant du mot, et on les juge appropriées lorsqu’il s’agit du terrorisme des ennemis.
[…]
Les définitions officielles du mot « terrorisme » posent un autre problème : elles impliquent que les États-Unis sont un des principaux États terroristes. Certes, il n’y a pas là matière à controverse, du moins chez ceux qui pensent que des institutions comme la Cour internationale de justice, le Conseil de sécurité de l’ONU ou les travaux d’universitaires appartenant au courant dominant méritent une certaine attention – les exemples du Nicaragua et de Cuba le montrent sans équivoque.
(1) L’US Code est le registre des lois générales et permanentes des États-Unis, classées par sujets. Sa version officielle est publiée tous les six ans par la Chambre des représentants. Sa version non officielle, plus répandue, comprend aussi l’essentiel de la jurisprudence concernant ces lois.
(2) Pour les définitions américaines, voir mon article « Le terrorisme international : image et réalité » [« International terrorism : image and reality », in A. George (éd.), Western State Terrorism, op. cit.], repris dans Pirates et Empreurs, op. cit. La définition britannique est citée par M. Curtis, Web of Deceit, op. cit., p.93
Noam Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète, pages 258 et 260
Voyons la distinction entre terrorisme et résistance. L’une des questions porte sur la légitimité des actes visant à concrétiser « le droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance, tel qu’il découle de la Charte des Nations unies, des peuples privés de ce droit par la force, […] notamment les peuples qui sont soumis à des régimes coloniaux ou racistes ainsi qu’à l’occupation étrangère ». Ces actes relèvent-ils du terrorisme ou de la résistance? Les phrases citées sont extraites de la dénonciation la plus vigoureuse du crime de terrorisme votée par l’Assemblée générale de l’ONU, qui se terminait ainsi : « rien dans la présente résolution ne saurait en aucune manière porter préjudice au droit » défini plus haut. La résolution a été adoptée en décembre 1987, alors que le terrorisme international officiellement reconnu comme tel était à son apogée. C’est évidemment important. Elle l’a été par 153 voix contre 2 (et une seule abstention, celle du Honduras) : c’est donc encore plus important (1).
Les deux voix contre étaient celles des pays habituels. Leurs motifs, ont-ils expliqué à la session de l’ONU, était le paragraphe que nous venons de citer. L’expression « régimes coloniaux ou racistes » leur paraissait viser l’Afrique du Sud de l’apartheid, leur alliée. Il est évident que les États-Unis et Israël ne pouvaient cautionner la résistance à l’apartheid, d’autant plus qu’elle était dirigée par l’ANC de Mandela, l’un des « groupes terroristes les plus notoires » de la planète, comme on disait à cette époque à Washington. L’autre expression, « occupation étrangère », semblait être une allusion à l’occupation militaire israélienne, alors dans sa vingtième année. On ne pouvait évidemment pas accepter la résistance dans ce cas-là non plus.
Les États-Unis et Israël ont été les seuls pays au monde à nier que les actes de ce type puissent relever d’une résistance légitime, et à les classer dans le terrorisme. La position américano-israélienne ne se limite pas aux territoires occupés. Les États-Unis et Israël considèrent le Hezbollah, par exemple, comme l’une des grandes organisations terroristes de la planète, non en raison de ses actes terroristes (qui sont réels), mais parce qu’il s’est constitué pour résister à l’occupation israélienne du Sud-Liban et qu’il a réussi à en expulser les envahisseurs, lesquels bravaient depuis vingt ans les décisions du Conseil de sécurité leur enjoignant de se retirer. Les États-Unis vont jusqu’à qualifier de « terroristes » des peuples qui résistent à leur agression directe : les Sud-Vietnamiens, par exemple, ou dernièrement les Irakiens. (2) »
(1) Résolution 42/159 de l’ONU, 7 décembre 1987. Le département d’État considère l’année 1987 comme celle de l’apogée du terrorisme.
(2) Pour une remarquable illustration au sujet du Vietnam, voir infra, p.266. Sur l’Irak, voir le correspondant d’ABC au Moyen-Orient Charles Glass, « I blame the British », London Review of Books, vol.25, numéro 8, 17 avril 2003.
Soulignons d’autres faits pertinents. Le motif officiel du bombardement de l’Afghanistan était de forcer les talibans à livrer des personnes que les États-Unis soupçonnaient d’être impliquées dans les crimes du 11 septembre – en refusant toutefois d’en fournir la moindre preuve. Alors que la réticence des talibans à s’exécuter était la principale information du jour et suscitait une vive fureur, Haïti a renouvelé sa demande d’extradition d’Emmanuel Constant, chef des forces paramilitaires qui ont eu une responsabilité majeure dans l’odieux assassinat de milliers de Haïtiens au cours des premières années de la décennie 1990, lorsque la junte militaire était soutenue, pas si tacitement que cela, par les administrations Bush I et Clinton. Cette demande n’a pas paru mériter la moindre réaction, ou pas plus qu’une simple mention sans commentaire. Emmanuel Constant avait été condamné in absentia en Haïti ; s’il témoignait, il risquait de révéler des contacts entre les terroristes d’État et Washington, et c’était cela, de l’avis de beaucoup, que craignaient les États-Unis. (1) Haïti a-t-il donc le droit de bombarder Washington, de tenter d’enlever ou d’assassiner Constant à New York, où il habite, en tuant aussi ses voisins, suivant la pratique approuvée pour Israël? Sinon, pourquoi? Pourquoi la question n’est-elle-même pas posée dans ce cas-là, ou dans celui des autres terroristes d’État meurtriers qui ont trouvé aux États-Unis un abris sûr? Et, si on la juge trop absurde pour être prise en considération (ce qu’elle est effectivement, à l’aune des critères moraux élémentaires), où cela laisse-t-il le consensus sur le recours à la violence par nos propres dirigeants?
Pensant au 11 septembre, certains soutiennent que le mal du terrorisme est « absolu » et nécessite en réponse une « doctrine tout aussi absolue » - une offensive militaire féroce, conformément au principe de Bush : « Si vous abritez des terroristes, vous êtes un terroriste ; si vous aidez et appuyez des terroristes, vous êtes un terroriste – et vous serez traité comme tel. » (2)
On aurait du mal à faire accepter par quiconque l’idée que le bombardement massif est une riposte légitime aux crimes terroristes. Aucun individu sain d’esprit ne dira qu’il serait légitime, dans le cadre de la « doctrine tout aussi absolue », de bombarder Washington en réponse à des atrocités terroristes. Aucun individu sain d’esprit ne dira qu’il serait légitime, dans le cadre de la « doctrine tout aussi absolue », de bombarder Washington en réponse à des atrocités terroristes, ou que ce serait une réaction justifiée et bien « dosée » à ces atrocités. S’il existe un raisonnement qui infirme cette remarque, il n’a pas encore été formulé, ni même pensé, à ma connaissance du moins.
(1) Daniel Grann, « Giving « the Devil » his due », Atlantic Monthly, vol. 287, numéro 6, juin 2001, p. 54-71.
(2) S. Talbott et N. Chanda (éd.), Age of Terror, op. cit., p.XV sq. Ce sont eux qui soulignent. Ils ajoutent que le prblème et la solution sont « plus compliqués », mais acceptent visiblement la conclusion et jugent le bombardement américano-britannique adapté et correctement « calibré ».
La distinction est élémentaire. On le sait bien chez ceux qui veulent atténuer les menaces terroristes : « Tant que les problèmes sociaux, politiques et économiques qui ont engendré Al-Qaida et d’autres organisations voisines ne seront pas réglés, les États-Unis et leurs alliés, en Europe occidentale et ailleurs, continueront à être visés par des terroristes islamiques. » Par conséquent, « les États-Unis doivent, pour leur propre protection, œuvrer davantage à réduire la pathologie de la haine, avant qu’elle ne se mue en un danger encore plus grand », en cherchant à « modérer […] les difficultés qui nourrissent la violence et le terrorisme ». La « clé, pour affaiblir stratégiquement Al-Qaida, c’est d’éroder sa base de soutien naissante – d’en détourner ses partisans actuels et potentiels ». Il est crucial, ajoute le stratège de Washington Paul Wolfowitz, d’éliminer des politiques qui ont été « un gigantesque outil de recrutement pour Al-Qaida » (1)
Rien ne pourra apaiser ceux « qui croient qu’un « choc des civilisations » avec l’Occident va rendre à l’Islam une puissance mondiale », écrivent les éditorialistes du Financial Times, mais, « pour les écraser […] avec succès, il faut les isoler de leur base, qui actuellement s’élargit ». Or, poursuivent-ils, « si seule la force peut détruire Al-Qaida, on ne pourra éroder sa base d’appui en expansion que par des politiques qui paraîtront justes aux Arabes et aux musulmans ». Même la destruction d’Al-Qaida ne servira pas à grand-chose si « les conditions fondamentales qui ont facilité son émergence et sa popularité – l’oppression politique et la marginalisation économique – persistent ». De même, en continuant à soutenir des « régimes abjects », Washington ne peut que « conforter les thèses d’Al-Qaida, qui affirme que les États-Unis appuient l’oppression des musulmans et patronnent des États répressifs (2) ». Cela sans parler des politiques spécifiques sur la Palestine, l’Irak et d’autres pays, qui ont transformé « une génération d’Arabes courtisée par les États-Unis et persuadée par ses principes en critiques parmi les plus tonitruants de la vision du monde de l’Amérique, [dont] de riches hommes d’affaires liés à l’Occident, des intellectuels formés aux États-Unis et des militants engagés pour les libertés (3) ».
On peut affaiblir considérablement des réseaux terroristes. Ce fut le cas d’Al-Qaida après le 11 septembre, grâce au genre de travail policier que recommande Michael Howard – notamment en Allemagne, au Pakistan et en Indonésie. Mais il faut appliquer à la « base de soutien » des méthodes radicalement différentes : prendre ses griefs en considération et, s’ils sont légitimes, leur apporter une réponse sérieuse, comme on devrait le faire hors de toute menace. « On ne peut pas éliminer les problèmes sociaux et politiques délicats par les bombes et les missiles », soulignent deux politologues : « En jetant des bombes, en lançant des missiles, les États-Unis ne font qu’étendre ces plaies suppurantes. La violence est assimilable à un virus. Plus on la bombarde, plus elle se répand » (4)
(1) Sumit Ganguly, « Putting South Asia back together again », Current History, vol. 100, numéro 650, décembre 2001, p.410-414 ; Philip C. Wilcox Jr., ambassadeur itinerant des États-Unis pour la lute antiterroriste, 1994-1997, « The terror », New York Review of Books, vol. 48, numéro 16, 18 octobre 2001 ; Rohan Gunaratna cite par Thomas Poers, “ Secrets of September 11”, New York Review of Books, vol.49, numéro 15, 10 octobre 2002. Interview de Wolfowitz par Sam Tennenhaus dans Vanity Fair, 9 mai 2003 ; il parle spécifiquement de la presence américaine en Arabie Saoudite.
(2) « Death in Riyadh : Crushing Al-Qaeda will require might and right”, editorial, Financial Times (Londres), 14 mai 2003, p.22 ; P.W. Singer, “American and the Islamic world”, Current History, vol. 101, numéro 658, novembre 2002, p. 355-364 ; Daniel Byman, “The war on terror requires subtler weapons”, Financial Times (Londres), 27 mai 2003, p.17.
(3) Anthony Shadid, “Old Arab friends turn away from US”, Washington Post, 26 février 2003, section A, p.1.
(4) James A.Bill et Rebecca Bill Chavez, “The politics of incoherence : The United States and the Middle East”, Middle East Journal, vol. 56, numéro 4, automne 2002, p.562-575.
Titre : Propagande, médias et démocratie
Auteur : Noam Chomsky et Robert W. McChesney
Genre : Politique, Analyse des médias
Date : 2004
Pages : 200
Éditeur : Les Éditions Écosociété
Collection : -
ISBN : 978-2-923165-10-3
« La propagande est à la société démocratique ce que la matraque est à l’État totalitaire ». Dans ce recueil de textes percutants – qui ont fait sa réputation comme analyste des médias – Noam Chomsky explique comment et pourquoi la démocratie libérale ne favorise pas l’existence de médias de masse libres et indépendants et, par extension, la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Remontant à la naissance de l’industrie des relations publiques ou analysant la couverture médiatique de l’actuelle « guerre contre la terreur », le célèbre linguiste du MIT démonte encore et toujours les mécanismes de cette « fabrication du consentement » au service du monde des affaires. Pour sa part, Robert W. McChesney nous fait comprendre en quoi les « géants des médias », résultant de la concentration de la propriété des moyens de communication, constituent aujourd’hui une grave menace pour la démocratie.
Car, au-delà de la désinformation, l’enjeu soulevé dans ce livre est : dans quel type de société voulons-nous vivre ? Une démocratie véritable ou un totalitarisme déguisé ? Propagande, médias et démocratie est un classique du genre.
Extraits :
Dans cet ouvrage, le célèbre analyste des médias Noam Chomsky et le professeur de communications à l’université de l’Illinois Robert W. McChesney démontent pour nous la mécanique de production de l’information aux États-Unis, qui se répercute à l’échelle mondiale. Le choc est violent mais salutaire, car tous deux nous amènent à nous demander dans quelle sorte de société nous souhaitons vivre et quelles sont nos responsabilités individuelles et collectives à ce sujet.
Dans Les exploits de la propagande, Chomsky remonte le cours du siècle pour nous expliquer à grands traits limpides le fonctionnement du système de propagande instauré au États-Unis au moment de la Première Guerre mondiale par l’élite du monde politique et du milieu des affaires; avec un mépris total pour la population, cette élite ne recule ni devant le mensonge ni devant la falsification de la réalité pour fabriquer l’opinion publique. Il montre aussi le rôle de la gigantesque industrie des relations publiques née à la même époque et le soutien que les médias et les personnalités parmi les plus influentes du monde journalistique apportent à ce système de propagande. « La propagande, écrit-il, est à la société démocratique ce qu’est la matraque à l’État totalitaire. »
Dans Le journaliste venu de Mars, Chomsky aborde un sujet de pleine actualité : la couverture médiatique de la guerre contre la terreur. Il y explique comment les États-Unis ont déclaré la prétendue « guerre contre le terrorisme » non le 11 septembre 2001, mais il y a plus de 20 ans, une guerre axée à ce moment-là sur le terrorisme international à soutien étatique dans le monde islamique et en Amérique centrale, et qu’ils poursuivent depuis. Il en donne la raison : les États-Unis, l’ensemble des pays et leurs médias analysent les crimes de l’ennemi avec la précision d’un laser mais ne reconnaissent jamais les leurs. Ils jouent d’hypocrisie en appliquant « à d’autres des normes qu’ils refusent d’admettre pour eux-mêmes ». Comme à l’accoutumée, Chomsky remonte la filière du temps pour le démontrer noir sur blanc.
Dans Les géants des médias, une menace pour la démocratie, McChesney établit on ne peut plus clairement que le contrôle des moyens de communication fait partie intégrante du pouvoir politique et économique. À la suite d’une vague d’acquisitions et de fusions, une poignée de consortiums géants possèdent désormais l’ensemble des moyens de communication américains, c’est-à-dire qu’ils contrôlent non seulement la majorité des médias de masse écrits ou électroniques, mais également le cinéma, la vidéo, la production de disques et jusqu’à l’édition de livres. Les magnats des médias ont une influence démesurée sur le contenu de l’information et sur l’ensemble de la culture, une influence qui suit évidemment leurs intérêts et leur idéologie et qui s’étend à l’échelle mondiale ; leurs positions sur les problèmes fondamentaux de notre époque sont celles du parti pris du profit et de la mondialisation du marché. McChesney a aussi le mérite de défaire les puissants mythes qui nous brouillent la vue. Il nous montre entre autres que, dans ce contexte, la liberté de presse et la liberté journalistique sont des réalités évanescentes et que l’espace public et démocratique qu’aurait pu offrir le développement des réseaux d’ordinateurs numériques, dont Internet, n’échappera pas à la soif commerciale de ces conglomérats gigantesques.
Noam Chomsky, Les exploits de la propagande, in Propagande, médias et démocratie, pages 8 et 10
Reinhold Niebuhr, chef de file des théologiens et critique de politique étrangère, quelquefois baptisé « le théologien des pouvoirs établis », le gourou de George Kennan et des intellectuels de l’administration Kennedy, soutenait que la faculté de raisonner est très peu répandue, que seul, un nombre restreint de personnes la possède. La plupart des gens se laissent dominer par leurs émotions et leurs impulsions. Ceux d’entre nous, expliquait-il, qui possèdent la faculté de raisonner doivent créer des « illusions nécessaires » et des « simplifications abusives, mais émotionnellement convaincantes » pour maintenir plus ou moins dans la bonne direction les simples d’esprits naïfs. Cette idée est devenue l’un des principaux thèmes des sciences politiques contemporaines. Durant les années 1920 et au début des années 1930, Harnold Lasswell, le fondateur du secteur moderne des communications et l’un des chefs de file américains des sciences politiques, expliquait qu’il n’était pas souhaitable de succomber « au dogme démocratique selon lequel les gens sont les meilleurs juges quand il s’agit de leurs propres intérêts », car ils ne le sont pas. Nous sommes les meilleurs juges en matière de bien commun, estimait-il. Par conséquent, par simple soucis de morale, il est indispensable de faire en sorte que les gens n’aient aucune possibilité d’agir en fonction de leur appréhension fausse des choses. Dans ce qu’on qualifie de nos jours d’État totalitaire ou d’État policier, c’est une tâche facile. Il suffit de brandir une matraque au-dessus de leurs têtes et de leur en asséner un bon coup s’ils s’écartent du droit chemin. Cependant, à mesure qu’une société devient plus libre et se démocratise, on est forcé d’abandonner cette option. Il faut donc recourir aux techniques de propagande. La logique est très simple. La propagande est à la société démocratique ce que la matraque est à l’État totalitaire. Encore une fois, dirons-nous, il est bon d’agir ainsi et c’est faire preuve de sagesse, car le bien commun échappe complètement au troupeau dérouté. Il est incapable de le comprendre.
Noam Chomsky, Les exploits de la propagande, in Propagande, médias et démocratie, pages 25 et 26
Le parti pris du marché repose souvent sur le mythe de la concurrence à l’état pur, selon lequel d’innombrables petits entrepreneurs bataillent pour servir la population en abaissant les prix, en améliorant la qualité des produits et en se livrant continuellement à une concurrence féroce. Cette conception du capitalisme, tellement présente dans le discours des Thatcher, Kemp, Pinochet et Friedman de ce monde, a fort peu de rapports avec la réalité du capitalisme. Ce serait un véritable cauchemar pour toute compagnie et les capitalistes qui réussissent s’arrangent, systématiquement et le plus rapidement possible, pour réduire les risques encourus en agrandissant leur entreprise et en éliminant la menace d’une concurrence directe. Par conséquent, la plupart des marchés de première importance ont tendance à devenir des oligopoles, dans lesquels une poignée d’entreprises domine les activités et érige de solides « barrières interdisant l’entrée » à de nouveaux concurrents. En terme de prix, de production et de profits, les industries oligopolistiques ressemblent bien plus à de purs monopoles qu’à des compagnies soumises à un marché concurrentiel mythique. Alors que les capitalistes s’adonnent aux délices du discours sur le marché libre, la réalité est celle d’un pouvoir économique extrêmement concentré qui n’a de comptes à rendre à personne. Cette situation a cours dans les industries de la publicité, des médias et des télécommunications plus que n’importe où ailleurs.
Noam Chomsky, Les exploits de la propagande, in Propagande, médias et démocratie, page 160
Titre : Quel rôle pour l’État?
Auteur : Noam Chomsky
Genre : Politique
Date : 2005
Pages : 45
Éditeur : Écosociété
Collection : -
ISBN : 2-923165-17-9
Quel est le rôle de l'État dans une société industrielle avancée ? Pour répondre à cette question, Chomsky revisite les fondements idéologiques de quatre modèles de société : le libéralisme classique, le socialisme libertaire, le socialisme d'État et le capitalisme d'État. Le constat qui se dégage d''un bref survol historique est sans appel. N'est qu''imposture, en effet, le parallèle entre le libéralisme, vecteur de l''actuelle mondialisation, et le libéralisme éclairé que prônait par exemple Humdoldt à la fin du dix-huitième siècle. Autre évidence : capitalisme et démocratie sont, au bout du compte, tout à fait incompatibles. Quant au socialisme d'État, qui a engendré la tyrannie soviétique, la cause est déjà entendue. Le socialisme libertaire sur lequel Chomsky a jeté son dévolu consiste à réaliser la synthèse des valeurs du socialisme et de l''anarchisme. En analysant les tenants et aboutissants du capitalisme d'État tel que pratiqué aujourd'hui, Chomsky nous démontre à quel point la démocratie citoyenne y a été sacrifiée au profit d'une classe dirigeante qui maintient ses acquis et ses profits; il avance la possibilité et la nécessité de renverser la situation avec un mouvement dédié à l'élimination de l'autorité répressive des grandes corporations et de l'État. Autant de questions essentielles qui nous font remonter aux sources de la pensée socio-politique de Chomsky.
Extraits :
Rien ne favorise plus la maturité requise pour la liberté que la liberté elle-même. Peut-être cette vérité ne sera-t-elle pas admise par ceux qui ont si souvent utilisé ce manque de maturité comme prétexte pour perpétuer la répression. Mais, sans aucun doute, elle me parait découler de la nature même de l’homme. L’inaptitude à la liberté ne peut résulter que d’un manque de pouvoir moral et intellectuel. Le seul moyen de combler cette lacune, c’est d’accroître ce pouvoir ; mais cela suppose l’exercice de ce même pouvoir, or cet exercice suppose la liberté qui éveille l’activité, or cet exercice suppose la liberté qui éveille l’activité spontanée.
Wilhelm von Humboldt, Essai sur les limites de l’action de l’État; en anglais, Limits of State Action, édité par J.W. Burrow (Londres, Cambridge University Press, 1969), chap. 16, p.143
Cité par Noam Chomsky, Quel rôle pour l’État?, page 27
[Joseph Schumpeter] décrit en effet la démocratie politique moderne, en terme favorables, comme le système dans lequel « les choix exercés par l’électorat [sont] d’importance secondaire par rapport à l’élection des hommes qui doivent prendre les décisions ». Le parti politique, affirme-t-il tout à fait avec raison, « est un groupe dont les membres proposent d’agir de concert dans un combat concurrentiel pour le pouvoir politique. S’il n’en était pas ainsi, il serait difficile pour des partis différents d’adopter exactement ou presque exactement le même programme (1) ». Voilà autant d’avantages de la démocratie politique telle qu’il la conçoit.
(1) Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie; en anglais, Capitalism, Socialism, and Democracy (New York, Harper & Row, 1950), p. 269, 283
Cité par Noam Chomsky, Quel rôle pour l’État?, pages 43 et 44
Titre : L’ivresse de la force
Auteur : Noam Chomsky
Genre : Géo-politique
Date : 2007
Pages : 217
Éditeur : Fayard
Collection : -
ISBN : 978-2-213-63678-8
L'ivresse et la force dont il est question ici sont bien sûr américaines. Car, selon Noam Chomsky, aujourd'hui les États-Unis agissent tout à fait dans l'esprit de l'orgueilleuse déclaration de George Bush père après la guerre du Golfe: What we say goes ("C'est nous qui commandons"). Mais, de l'Amérique latine qui relève la tête au Moyen-Orient qui résiste, le monde réel ne l'entend pas de cette oreille. Dans ce nouveau recueil d'entretiens avec David Barsamian, Chomsky analyse cette riposte mondiale en alliant les explications historiques à des informations précises sur les événements mondiaux les plus récents, informations parfois recueillies directement sur le terrain (comme au Liban ou dans plusieurs pays d'Amérique latine). Avec la lucidité critique qu'on lui connaît, il aborde le bourbier irakien, les dernières phases du conflit israélo-palestinien, la guerre du Liban et ses suites, les tensions actuelles avec l'Iran, le bilan des succès de la gauche latino-américaine, les politiques néolibérales en Inde... Il insiste aussi sur l'impact mondial du déficit démocratique aux États-Unis, et sur les réactions de plus en plus nombreuses qu'il suscite au sein de la population américaine. Un essai stimulant pour comprendre tous les enjeux de la politique internationale de notre temps, par le penseur critique que le Boston Globe considère comme "le citoyen le plus utile d'Amérique"
Extraits :
Extrait entretiens du 10 février 2006, Cambridge, Massachusetts
On amena un pirate devant Alexandre, qui lui lança : « Comment oses-tu infester les mers, brigant? » « Comment oses-tu infester l’univers? Répondit le pirate. J’ai un petit bateau : on m’appelle pirate. Tu as une flotte puissante : on t’appelle empereur. Mais toi, tu molestes le monde entier ; moi, en comparaison, je ne fais presque rien. » C’est ainsi : l’empereur a le droit de molester le monde entier, mais le pirate passe pour un criminel abominable.
Noam Chomsky, L’ivresse de la force, Entretiens avec David Barsamian, page 6
Extrait entretiens du 15 août 2006, Cambridge, Massachusetts
Du point de vue de Washington, toute démocratie émergente doit être subordonnée aux intérêts américains. Les États-Unis veulent faire du Liban un centre commercial et financier au service des riches. C’est une des raisons de la montée en puissance du Hezbollah : le gouvernement libanais n’a rien fait pour les chiites pauvres du sud de Beyrouth et du Liban-Sud. Le prestige du Hezbollah ne vient pas seulement de son rôle de dirigeant dans la guérilla qui a chassé Israël du Liban en 2000, mais aussi des services sociaux qu’il assure – la santé, l’éducation, l’aide financière. Pour beaucoup de Libanais, le Hezbollah, c’est l’État. Comme pour d’autres mouvements fondamentalistes islamiques, tel est le fondement de l’énorme soutien populaire dont il jouit. Il n’est pas souhaitable que des acteurs « non gouvernementaux », surtout armés, deviennent un « État dans l’État », mais si les problèmes fondamentaux ne sont pas réglés, c’est ce qui va se passer. C’est presque inévitable. En fait, les États-Unis et Israël ont beaucoup aidé à créer l’extrémisme fondamentaliste musulman, en détruisant le nationalisme laïque. Si on détruit les forces nationalistes laïques, la population ne va pas dire : « Allez-y, égorgez-moi. » Elle va se tourner vers autre chose. Et cet « autre chose », c’est l’extrémisme religieux.
Parfois, d’ailleurs, on encourage activement ces mouvements. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont le plus ferme soutien extérieur de l’extrémisme islamique. L’allié le plus ancien et le plus précieux de Washington dans le monde arabe est l’Arabie Saoudite. En comparaison, l’Iran est un paradis de la démocratie. Pour la dictature fondamentaliste d’Arabie Saoudite, la grande menace était le nationalisme laïque, essentiellement incarné par Gamal Abdel Nasser. Nasser est donc devenu un ennemi parce qu’il menaçait l’Arabie Saoudite, base américaine de l’extrémisme religieux, qui incidemment contrôle le pétrole, la raison sous-jacente. En 1967, Israël a rendu un immense service aux États-Unis, à l’Arabie Saoudite et aux compagnies pétrolières en éliminant le nationalisme arabe laïque, qui menaçait d’utiliser les ressources de la région au profit de la population locale. Et ça, c’est intolérable. Ce sont « nos » ressources, George Kennan l’a dit depuis longtemps, et nous devons les « protéger ».
Kennan, cité dans Walter LaFeber, Inevitable Revolutions : The United States in Central America, éd. révisée, New York. W.W. Norton, 1983, p. 109 et 112
Noam Chomsky, L’ivresse de la force, Entretiens avec David Barsamian, pages 29 et 30
Extrait entretiens du 15 août 2006, Cambridge, Massachusetts
Le problème de l’enrichissement de l’uranium au niveau de la « qualité militaire » est très grave. Le destin de notre espèce en dépend. Si ce type d’enrichissement continue, nous risquons de ne pas survivre bien longtemps. Des solutions ont été suggérées. La plus importante vient de Mohamed el-Baradei, le très respecté directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique et Prix Nobel de la paix. Il propose de placer la production de matières fissiles de qualité militaire sous contrôle et supervision internationale ; ceux qui auront besoin de matières fissiles à des fins pacifiques les demanderont à l’AIEA. C’est une proposition très raisonnable. À ma connaissance, un seul pays du monde l’a acceptée : l’Iran. Essayez donc d’en trouver mention quelque part.
Noam Chomsky, L’ivresse de la force, Entretiens avec David Barsamian, page 37
Extrait entretiens du 29 septembre 2006, Cambridge, Massachusetts
En fait, il est très intéressant de voir ce que signifie, pour les États-Unis, « antidémocratique ». Quand Evo Morales s’est orienté vers la nationalisation des ressources boliviennes, on l’a accusé d’être autoritaire, dictatorial, d’attaquer la démocratie. Et qu’il ait le soutien de 95% de la population, c’est un détail? Est-ce le sens de « dictatorial »? Notre vision de la démocratie est bien particulière, c’est : « Faites ce qu’on vous dit! » Dans ce cas, un pays est démocratique, ou en passe de le devenir. Mais s’il fait ce que veut sa population, il n’est pas démocratique. Il est terrible que les gens ne s’en rendent pas compte.
Richard Lapper et Hal Weitzman, « Chavez Casts a Long Anti-American Shadow Over Regional Capitals”, Financial Times (Londres), 3 mai 2006
Noam Chomsky, L’ivresse de la force, Entretiens avec David Barsamian, page 54
Extrait entretiens du 29 janvier 2007, Cambridge, Massachusetts
Les années récentes ont été les premières où l’épargne a été négative. Une grande partie des ménages ont pour toute fortune la propriété de leur maison, ce qui est une base assez fragile. On a de bonnes raisons de penser qu’il y a aujourd’hui une bulle immobilière qui a permis de surmonter l’éclatement de la boule boursière. Si la bulle immobilière éclate, cela pourrait être très grave. En fait, le marché immobilier donne déjà des signes de faiblesse*. Il y a un autre risque réel : les principaux créanciers qui détiennent des instruments de la dette américaine – notamment la Chine, mais aussi le Japon – pourraient décider de diversifier leurs réserves.
Mark Trumbull, « The Squeeze on American Pocket-books », Christian Science Monitor, 3 février 2006
* Depuis la redaction du texte original de ce chapitre, la bulle immobilière, on le sait, a éclaté avec la crise des subprimes.
Noam Chomsky, L’ivresse de la force, Entretiens avec David Barsamian, page 111
Extrait entretiens du 2 février 2007, Cambridge, Massachusetts
« L’impérialisme, écrit Hannah Arendt, aurait dû inventer le racisme comme seule « explication » et seule excuse possible pour ses méfaits, même s’il n’avait jamais existé de pensée raciale dans le monde civilisé. »
Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme, trad. Fr. de Jean-Loup Bourget, Robert Davreu et Patrick Lévy, Paris, Seuil, 2005, pages 448 à 449
Noam Chomsky, L’ivresse de la force, Entretiens avec David Barsamian, page 140
Extrait entretiens du 12 mars 2007, Lexington, Massachusetts
Corrélation que d’autres aussi ont remarquée : un des meilleurs, peut-être le meilleur spécialiste des droits de l’homme en Amérique latine, Lars Schoultz, de l’université de Caroline du Nord, a publié dès 1981 un article qui soulignait qu’ « une part disproportionnée de l’aide des États-Unis » allait « aux régimes latino-américains qui torturent leur population » et « à des gouvernements assez connus pour leur mépris des droits humains fondamentaux dans le sous-continent ». Cette aide comprenait une assistance militaire, et elle s’est poursuivie sans discontinuer jusqu’à la fin de l’administration Carter. Sous Reagan, je crois que personne ne s’est donné la peine de vérifier, tant c’était évident. Et elle a continué sans interruption- jusqu’à aujourd’hui. Sous Clinton, la Colombie a été largement le pays le plus aidé par les États-Unis, et les violations des droits de l’homme y ont été de loin les pires de toute l’Amérique latine. Ce qui suffit à la démonstration.
Lars Schoultz, « US Foreign Policy and Human Rights Violations in Latin America : A Comparative Analysis of Foreign Aid Distributions”, Comparative Politics, vol. 13, numéro 2, janvier 1981, pages 155 à 157
Pour une analyse, voir Chomsky, Dominer le monde ou sauver la planète?, pages 74 à 76.
Noam Chomsky, L’ivresse de la force, Entretiens avec David Barsamian, page 189
Extrait entretiens du 12 mars 2007, Lexington, Massachusetts
La guerre suivant son cours, dans les années 1943-1944, il est devenu évident que l’Allemagne allait être vaincue, et la Grande Zone a alors été étendue à tout l’espace que les États-Unis pourraient dominer dans le monde. Le but était de créer un ordre international libéral où les entreprises américaines pourraient agir librement. N’oublions pas à quel point les États-Unis étaient en avance sur tous les autres après les ravages de la guerre. En fait, ils ont été les grands gagnants du conflit : leur production industrielle a triplé ou quadruplé alors que celle de la plupart de leurs concurrents était dévastée ou du moins affaiblies. Au sortir de la guerre, les États-Unis avaient la moitié de la fortune mondiale, donc un ordre international libéral était tolérable. On pouvait avoir une concurrence relativement libre puisqu’on était sûr que l’équilibre fondamental penchait en notre faveur. Ce serait un système international où les entreprises américaines pourraient accéder librement aux ressources, aux marchés, investir sans contraintes. Telle est l’idée de base de l’ordre international.
Noam Chomsky, L’ivresse de la force, Entretiens avec David Barsamian, pages 195 et 196
Extrait entretiens du 12 mars 2007, Lexington, Massachusetts
Les États-Unis violent totalement le traité illégitime qu’ils ont imposé. Ils ne se servent pas de Guantanamo comme d’un dépôt de charbon. Ils avaient déjà violé le traité quand ils avaient utilisé Guantanamo pour parquer des réfugiés haïtiens. Washington ne voulait pas appliquer l’article de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui stipule : « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. » On avait donc refoulé les réfugiés en les envoyant à Guantanamo, ce qui revenait à les interner. Aujurd’hui, les États-Unis envoient à Guantanamo des détenus qu’ils veulent maintenir en dehors du droit national ou international. La Cour suprême a fait savoir qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur les droits des détenus de Guantanamo, parce que Guantanamo ne relève pas de la juridiction nationale des États-Unis ; l’administration Bush et le Congrès ont expressément déclaré que Guantanamo n’est pas couvert par le droit international. C’est donc très pratique comme centre de torture.
Article 14, paragraphe 1, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies
Lynne Duke, « US Camp for Haitians Described as prison-like », Washington Post, 19 septembre 1992
Amy Goldstein, “Justice won’t hear detainee rights cases – for now”, Washington Post, 3 avril 2007
Noam Chomsky, L’ivresse de la force, Entretiens avec David Barsamian, page 198
Extrait entretiens du 12 mars 2007, Lexington, Massachusetts
Ce matin, le Boston Globe a donné une information connue ici depuis longtemps. En 1974, sans doute à l’initiative du gouvernement des États-Unis, le MIT a conclu un contrat avec le shah d’Iran. Il louait de facto à l’Iran son département de génie nucléaire, ou une grande partie, pour former un très grand nombre d’ingénieurs iraniens à l’enrichissement de l’uranium et à d’autres techniques de développement du nucléaire. En échange, le shah, qui était l’un des dictateurs les plus brutaux de l’époque et pratiquait d’horribles violations des droits de l’homme, versait au moins un demi-million de dollars au MIT. L’article souligne aussi que plusieurs des ingénieurs qui ont été formés au MIT gèrent aujourd’hui, évidemment, les programmes nucléaires iraniens. Des programmes qui étaient vigoureusement soutenus par les États-Unis au milieu des années 1970.
Farah Stockman, « Iran’s nuclear vision first glimpsed at MIT”, Boston Globe, 12 mars 2007
Noam Chomsky, L’ivresse de la force, Entretiens avec David Barsamian, page 201
Extrait entretiens du 12 mars 2007, Lexington, Massachusetts
Vous avez dit, je l’ai relevé avec intérêt, qu’Israël et l’Éthiopie n’ont pas de frontières définies, reconnues. Vous avec expliqué le cas de l’Éthiopie, mais qu’en est-il d’Israël?
Israël n’a jamais défini ses frontières. En fait, il les élargit systématiquement, avec le soutien des États-Unis. Tout ce que fait Israël, pratiquement, il le fait avec le feu vert des États-Unis et avec leur soutien diplomatique, économique, militaire et idéologique. Il s’est étendu illégalement sur les territoires occupés. Le mur qu’Israël construit traverse la Cisjordanie, entoure les colonies juives, s’empare d’une bonne partie des terres arables et de la ressource la plus précieuse, l’eau, après quoi de nombreuses zones palestiniennes ne sont pratiquement plus viables. Les territoires laissés aux Palestiniens sont fragmentés par des centaines de checkpoints et autres barrages qui entravent les transports, etc.
On utilise constamment l’expression « droit à l’existence ». Quand cette formule a-t-elle été introduite?
Je n’ai jamais lu d’étude détaillée sur ce point, mais j’ai la ferme impression que l’idée du « droit à l’existence » d’Israël a été soit inventée, soit mise en avant au milieu des années 1970, probablement en réaction au fait que les principaux États arables, avec le soutien de l’OLP, avaient accepté le droit d’Israël à exister dans des frontières sûres et reconnues.
Les frontières fixées par l’ONU en 1949?
Oui, la frontière internationale reconnue. Les Arabes ont admis le droit de tous les États de la région, Israël compris, à exister dans des frontières sûres et reconnues. Et cela concernait aussi, en 1976, un État palestinien dans les territoires occupés. Tout cela a été proposé aux Nations unies en janvier 1976, dans une résolution parrainée par les grands États arabes, les États dits de la confrontation, Syrie, Jordanie et Égypte, avec le soutien de l’OLP et d’autres. Les États-Unis ont opposé leur veto à cette résolution, elle est donc sortie de l’histoire. Mais c’est à ce moment-là, je pense, qu’ils ont compris qu’il leur fallait mettre la barre plus haut pour empêcher un règlement diplomatique. En rester au « droit de vivre dans des frontières sûres et reconnues » ne suffirait pas. Il fallait bloquer la diplomatie. C’est alors qu’on vit apparaitre ostensiblement le concept de « droit à l’existence ». Exiger que les Palestiniens ou les Arabes – ou n’importe qui, d’ailleurs – acceptent le droit d’Israël à l’existence, c’est octroyer à Israël un droit dont aucun autre État ne jouit dans le système international. On n’accorde à aucun État un droit à l’existence. On reconnait les États, mais on ne leur reconnaît pas un droit d’exister.
Dans le cas d’Israël, cela revient à exiger des Palestiniens qu’ils reconnaissent la légitimité de leur expulsion – pas seulement qu’ils admettent le fait, mais sa légitimité. C’est comme si l’on demandait au Mexique de reconnaître le droit à l’existence des États-Unis sur la moitié de son territoire, dont ils se sont emparés par la force. Les Mexicains ne l’acceptent pas, et n’ont pas à le faire. Presque toutes les frontières du monde résultent d’une conquête. Ces frontières sont reconnues, mais personne n’exige en plus que leur légitime soit reconnue, surtout par une population qui a été chassée.
Amira Hass a énormément écrit sur les fermetures de frontières et les checkpoints dans une série d’articles pour Ha’aretz, à paraître sous une forme plus étoffée chez Metropolitan Books; voir aussi supra, chap. II, n. 11, et Amira Hass, avant-propos de Yehudit Kirstein Keshet, Checkpoint Watch : testimonies from occupied Palestine, Londres, Zed Books, 2006, p.X-XVII.
Pour une analyse, voir Chomsky, Israël, Palestine, États-Unis : le triangle fatidique, p.105-110
Noam Chomsky, L’ivresse de la force, Entretiens avec David Barsamian, pages 209 à 211
Résolution 497 du conseil de sécurité de l’ONU, 17 décembre 1981 :
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la lettre du représentant permanent de la République arabe syrienne en date du 14 décembre 1981 qui figure dans le document S/14791,
Réaffirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
1. Décide que la décision prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration dans le territoire syrien occupé des hauteurs du Golan est nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international ;
2. Exige qu’Israël, la Puissance occupante, rapporte sans délai sa décision ;
3. Déclare que toutes les dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, continuent de s’appliquer au territoire syrien occupé par Israël depuis juin 1967 ;
4. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur l’application de la présente résolution dans un délai de deux semaines et décide que, au cas où Israël ne s’y conformerait pas, le Conseil de sécurité se réunira d’urgence, le 5 janvier 1982 au plus tard, pour envisager de prendre les mesures appropriées conformément à la Charte des Nations Unies.
La Chartre des Nations unies :
Article 2
L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.
Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte.
Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.
Titre : Propagande, médias et démocratie
Auteur : Noam Chomsky et Robert W. McChesney
Genre : Politique, Analyse des médias
Date : 2004
Pages : 200
Éditeur : Les Éditions Écosociété
Collection : -
ISBN : 978-2-923165-10-3
« La propagande à la société démocratique ce que la matraque est à l’État totalitaire ». Dans ce recueil de textes percutants – qui ont fait sa réputation comme analyste des médias – Noam Chomsky explique comment et pourquoi la démocratie libérale ne favorise pas l’existence de médias de masse libres et indépendants et, par extension, la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Remontant à la naissance de l’industrie des relations publiques ou analysant la couverture médiatique de l’actuelle « guerre contre la terreur », le célèbre linguiste du MIT démonte encore et toujours les mécanismes de cette « fabrication du consentement » au service du monde des affaires. Pour sa part, Robert W. McChesney nous fait comprendre en quoi les « géants des médias », résultant de la concentration de la propriété des moyens de communication, constituent aujourd’hui une grave menace pour la démocratie.
Car, au-delà de la désinformation, l’enjeu soulevé dans ce livre est : dans quel type de société voulons-nous vivre ? Une démocratie véritable ou un totalitarisme déguisé ? Propagande, médias et démocratie est un classique du genre.
Extraits :
Dans cet ouvrage, le célèbre analyste des médias Noam Chomsky et le professeur de communications à l’université de l’Illinois Robert W. McChesney démontent pour nous la mécanique de production de l’information aux États-Unis, qui se répercute à l’échelle mondiale. Le choc est violent mais salutaire, car tous deux nous amènent à nous demander dans quelle sorte de société nous souhaitons vivre et quelles sont nos responsabilité individuelles et collectives à ce sujet.
Dans Les exploits de la propagande, Chomsky remonte le cours du siècle pour nous expliquer à grands traits limpides le fonctionnement du système de propagande instauré au États-Unis au moment de la Première Guerre mondiale par l’élite du monde politique et du milieu des affaires; avec un mépris total pour la population, cette élite ne recule ni devant le mensonge ni devant la falsification de la réalité pour fabriquer l’opinion publique. Il montre aussi le rôle de la gigantesque industrie des relations publiques née à la même époque et le soutien que les médias et les personnalités parmi les plus influentes du monde journalistique apportent à ce système de propagande. « La propagande, écrit-il, est à la société démocratique ce qu’est la matraque à l’État totalitaire. »
Dans Le journaliste venu de Mars, Chomsky aborde un sujet de pleine actualité : la couverture médiatique de la guerre contre la terreur. Il y explique comment les États-Unis ont déclaré la prétendue « guerre contre le terrorisme » non le 11 septembre 2001, mais il y a plus de 20 ans, une guerre axée à ce moment-là sur le terrorisme international à soutien étatique dans le monde islamique et en Amérique centrale, et qu’ils poursuivent depuis. Il en donne la raison : les États-Unis, l’ensemble des pays et leurs médias analysent les crimes de l’ennemi avec la précision d’un laser mais ne reconnaissent jamais les leurs. Ils jouent d’hypocrisie en appliquant « à d’autres des normes qu’ils refusent d’admettre pour eux-mêmes ». Comme à l’accoutumée, Chomsky remonte la filière du temps pour le démontrer noir sur blanc.
Dans Les géants des médias, une menace pour la démocratie, McChesney établit on ne peut plus clairement que le contrôle des moyens de communication fait partie intégrante du pouvoir politique et économique. À la suite d’une vague d’acquisitions et de fusions, une poignée de consortiums géants possèdent désormais l’ensemble des moyens de communication américains, c’est-à-dire qu’ils contrôlent non seulement la majorité des médias de masse écrits ou électroniques, mais également le cinéma, la vidéo, la production de disques et jusqu’à l’édition de livres. Les magnats des médias ont une influence démesurée sur le contenu de l’information et sur l’ensemble de la culture, une influence qui suit évidemment leurs intérêts et leur idéologie et qui s’étend à l’échelle mondiale ; leurs positions sur les problèmes fondamentaux de notre époque sont celles du parti pris du profit et de la mondialisation du marché. McChesney a aussi le mérite de défaire les puissants mythes qui nous brouillent la vue. Il nous montre entre autres que, dans ce contexte, la liberté de presse et la liberté journalistique sont des réalités évanescentes et que l’espace public et démocratique qu’aurait pu offrir le développement des réseaux d’ordinateurs numériques, dont Internet, n’échappera pas à la soif commerciale de ces conglomérats gigantesques.
Noam Chomsky, Les exploits de la propagande, in Propagande, médias et démocratie, pages 8 et 10
Reinhold Niebuhr, chef de file des théologiens et critique de politique étrangère, quelquefois baptisé « le théologien des pouvoirs établis », le gourou de George Kennan et des intellectuels de l’administration Kennedy, soutenait que la faculté de raisonner est très peu répandue, que seul, un nombre restreint de personnes la possède. La plupart des gens se laissent dominer par leurs émotions et leurs impulsions. Ceux d’entre nous, expliquait-il, qui possèdent la faculté de raisonner doivent créer des « illusions nécessaires » et des « simplifications abusives, mais émotionnellement convaincantes » pour maintenir plus ou moins dans la bonne direction les simples d’esprits naïfs. Cette idée est devenue l’un des principaux thèmes des sciences politiques contemporaines. Durant les années 1920 et au début des années 1930, Harnold Lasswell, le fondateur du secteur moderne des communications et l’un des chefs de file américains des sciences politiques, expliquait qu’il n’était pas souhaitable de succomber « au dogme démocratique selon lequel les gens sont les meilleurs juges quand il s’agit de leurs propres intérêts », car ils ne le sont pas. Nous sommes les meilleurs juges en matière de bien commun, estimait-il. Par conséquent, par simple soucis de morale, il est indispensable de faire en sorte que les gens n’aient aucune possibilité d’agir en fonction de leur appréhension fausse des choses. Dans ce qu’on qualifie de nos jours d’État totalitaire ou d’État policier, c’est une tâche facile. Il suffit de brandir une matraque au-dessus de leurs têtes et de leur en asséner un bon coup s’ils s’écartent du droit chemin. Cependant, à mesure qu’une société devient plus libre et se démocratise, on est forcé d’abandonner cette option. Il faut donc recourir aux techniques de propagande. La logique est très simple. La propagande est à la société démocratique ce que la matraque est à l’État totalitaire. Encore une fois, dirons-nous, il est bon d’agir ainsi et c’est faire preuve de sagesse, car le bien commun échappe complètement au troupeau dérouté. Il est incapable de le comprendre.
Noam Chomsky, Les exploits de la propagande, in Propagande, médias et démocratie, pages 25 et 26
Le parti pris du marché repose souvent sur le mythe de la concurrence à l’état pur, selon lequel d’innombrables petits entrepreneurs bataillent pour servir la population en abaissant les prix, en améliorant la qualité des produits et en se livrant continuellement à une concurrence féroce. Cette conception du capitalisme, tellement présente dans le discours des Thatcher, Kemp, Pinochet et Friedman de ce monde, a fort peu de rapports avec la réalité du capitalisme. Ce serait un véritable cauchemar pour toute compagnie et les capitalistes qui réussissent s’arrangent, systématiquement et le plus rapidement possible, pour réduire les risques encourus en agrandissant leur entreprise et en éliminant la menace d’une concurrence directe. Par conséquent, la plupart des marchés de première importance ont tendance à devenir des oligopoles, dans lesquels une poignée d’entreprises domine les activités et érige de solides « barrières interdisant l’entrée » à de nouveaux concurrents. En terme de prix, de production et de profits, les industries oligopolistiques ressemblent bien plus à de purs monopoles qu’à des compagnies soumises à un marché concurrentiel mythique. Alors que les capitalistes s’adonnent aux délices du discours sur le marché libre, la réalité est celle d’un pouvoir économique extrêmement concentré qui n’a de comptes à rendre à personne. Cette situation a cours dans les industries de la publicité, des médias et des télécommunications plus que n’importe où ailleurs.
Noam Chomsky, Les exploits de la propagande, in Propagande, médias et démocratie, page 160



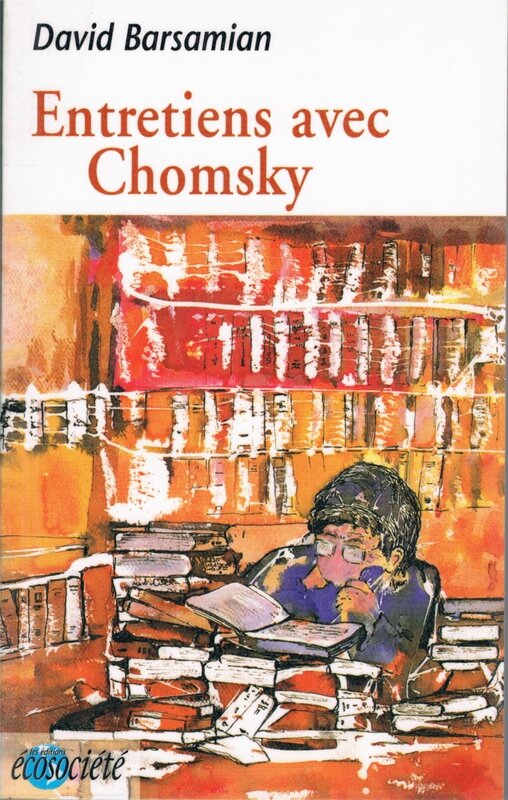


![367924291[1]](https://storage.canalblog.com/27/28/1274499/98570376.jpg)



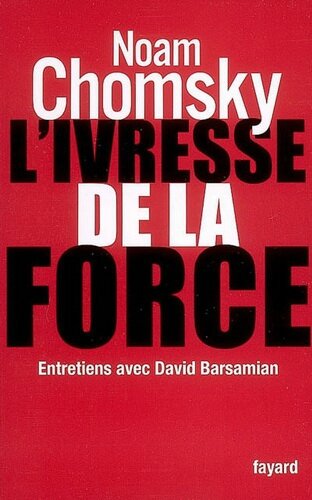



/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F80%2F30%2F1274499%2F134112177_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F15%2F09%2F1274499%2F132610075_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F53%2F26%2F1274499%2F124227922_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F33%2F04%2F1274499%2F119812371_o.jpg)