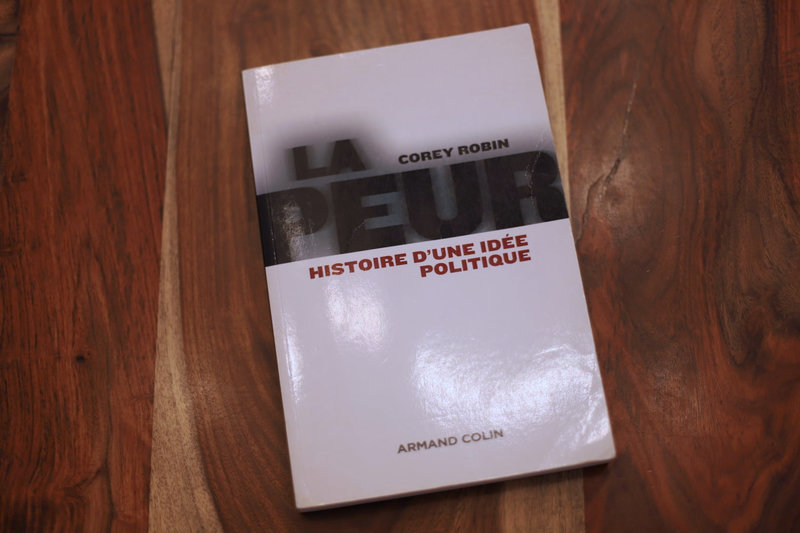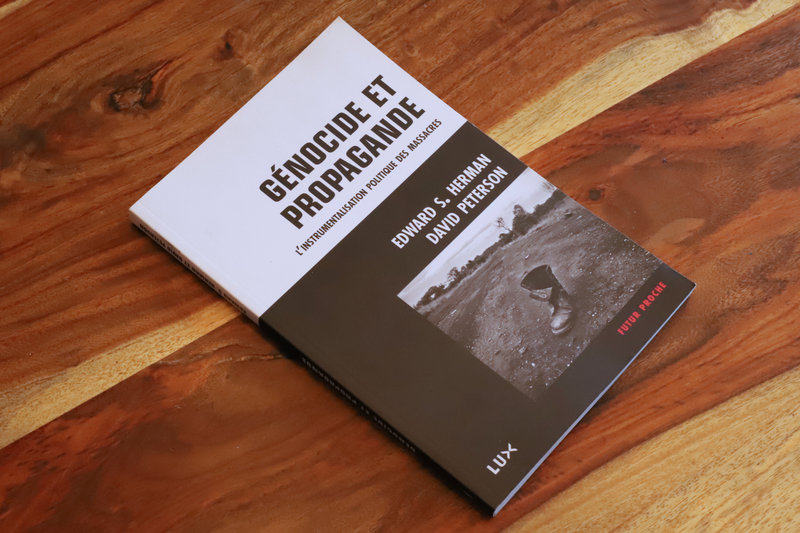Corey Robin est professeur de science politique au Brooklyn College et au Graduate Center (New York City University). Il est l'auteur de plusieurs livres, dont La Peur : histoire d'une idée politique (Armand Colin, 2006). Il écrit aussi pour la presse, notamment pour The New York Times et The Washington Post.
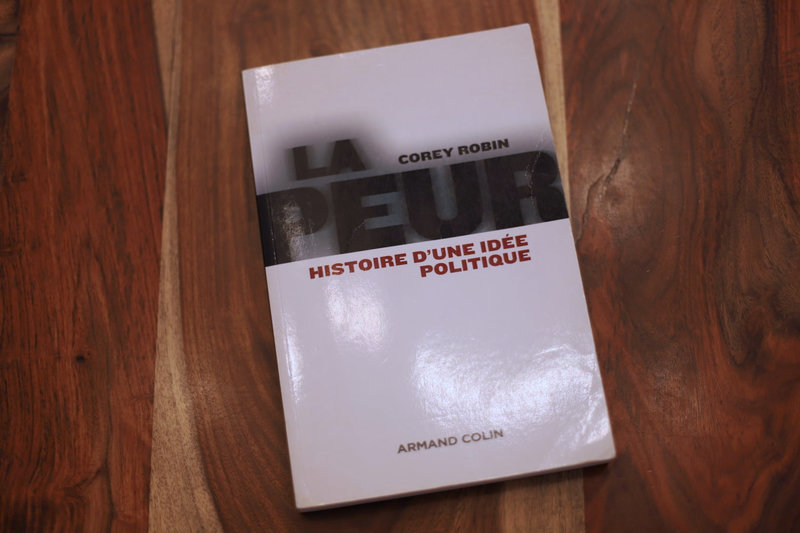
Nous savons tous, intuitivement, que la peur joue un rôle dans la vie politique d’un pays. Et pas seulement lors d’évènements exceptionnels comme les attentats du 11 septembre à New York. Mais, parce qu’il est humiliant d’avoir peur et de se l’avouer, nous en minimisons irrésistiblement l’influence, préférant nous réfugier derrière des explications plus « rationnelles » du comportement des gouvernants comme des citoyens.
Le maître-livre de Corey Robin déchire ce voile d’ignorance. Dans une analyse à la fois brillante et provoquante, très largement saluée lors de sa récente publication aux États-Unis, il montre en quoi la peur constitue un levier fondamental de pouvoir, même dans une démocratie libérale comme la nôtre. L’auteur conjugue ici une analyse historique de l’idée de peur (de Hobbes à Hanna Arendt en passant par Montesquieu et Tocqueville) avec une description concrète, menée sans complaisance, de la vie politique américaine actuelle. Il s’en dégage une démonstration particulière efficace qui déborde le cadre strictement américain pour s’appliquer à tout fonctionnement démocratique. Si cette thèse originale trouble certainement notre confort intellectuel, elle peut aussi nous dessiller politiquement les yeux pour des lendemains mieux libérés de la peur.
Extraits :
Mais l’originalité profonde du livre de Corey Robin se situe ailleurs : dans son ambition de nous offrir une véritable théorie générale de la peur dans le champ politique. Cette émotion primaire, aux contours fluides, nous est présente ici comme un levier universel de pouvoir, ce qui n’avait pas échappé aux plus pénétrants de nos philosophes politiques, mais que nous avions largement oublié ; et, bien loin de rester circonscrite aux régimes dictatoriaux qui, c’est vrai, en font de beaucoup le plus large usage, elle constitue un instrument majeur de domination même dans nos démocraties libérales. Plus embarrassant encore, l’auteur nous montre que la peur est souvent considérée par les intellectuels les plus avancés comme un moyen, mieux assuré que d’autres, de fonder l’ordre politique. Le lecteur sera donc surpris de pouvoir disposer d’une focale qui lui permet d’embrasser un champ beaucoup plus vaste que les considérations trop attendues sur les politiques de la peur dont l’extrême droite aurait l’exclusif apanage.
Corel Robin, préface de Philippe Braud, La peur, Histoire d’une idée politique, page 5
Selon moi, la peur n’est ni ce qui sauvera l’individu et la société, ni un phénomène étranger à la sphère politique, que celle-ci soit de nature libérale ou non. La peur est, au contraire, un instrument au service d’une élite au pouvoir ou d’insurgés en marche, instrument créé et façonné par des responsables (ou des activistes) qui espèrent en tirer un bénéfice, soit parce qu’elle peut les aider à atteindre un objectif politique déterminé, soit parce qu’elle reflète ou donne du poids à leurs croyances morales et politiques, quand ce n’est pas pur ces deux raisons réunies. […] La peur à caractère politique obéit généralement à deux schémas alternatifs. Dans le premier, des dirigeants ou des militants politiques définissent ce qui est ou doit être le principal objet de terreur pour l’opinion publique. Cette sorte de peur se nourrit généralement d’une menace réelle : elle est très rarement créée ex nihilo ; mais, dans la mesure où les peines de l’existence sont à peu près aussi variées que ses plaisirs, les dirigeants disposent d’une marge assez grande pour décider quelle menace mérite ou non d’être prise au sérieux par la collectivité. Ce sont eux qui identifient le danger pesant sur le bien-être de la population, qui en interprètent la nature et la cause, et qui proposent des solutions pour y faire face. Ce sont eux qui décident que telle peur est digne d’être un sujet de débat public et de mobilisation politique. Cela ne veut pas dire que chaque citoyen redoute la menace ainsi identifiée […], mais que cette menace dominera l’agenda politique au détriment d’autres sujets de crainte ou de préoccupation. Ce faisant, les dirigeants agissent naturellement sous l’influence de leurs objectifs stratégiques et de leurs présupposés idéologiques. Ils analysent la menace à travers un schéma idéologique qui façonne leur perception du danger qu’elle représente et la mesurent à l’aune de l’opportunité politique, qui leur permet d’évaluer s’ils ont intérêt ou non, politiquement, à l’utiliser.
Corel Robin, La peur, Histoire d’une idée politique, page 29
Jusqu’ici, seul le premier schéma de peur à caractère politique a été évoqué : celui qui repose sur la définition et l’interprétation, par des dirigeants politiques, d’objets publics de crainte et d’inquiétude. Ce schéma suppose que les dirigeants et le peuple vers qui ils se tournent partagent une identité commune et que les deux groupes, de ce fait, se sentent pareillement menacés. Ce n’est évidemment pas un hasard si ce schéma est si fréquent en temps de guerre. En effet, c’est la nation, ou toute communauté dotée d’une cohésion analogue, qui en est le constituant principal. De même, c’est l’ennemi étranger, ou toute autre figure de l’Autre, comme le trafiquant de drogue, le criminel ou l’immigré, qui en est généralement l’objet privilégié. Mais la peur, suivant un tout autre schéma, peut aussi naître des hiérarchies sociales, politiques et économiques qui divisent une nation. Et si cette peur est, elle aussi, créée, orientée et manipulée par les élites politiques, elle poursuit un objectif tout à fait particulier : l’intimidation interne. Il s’agit ici d’utiliser la sanction ou la menace de la sanction pour faire en sorte qu’un groupe maintienne ou accroisse son pouvoir au détriment des autres. Tandis que le premier schéma suppose la peur commune d’un danger lointain ou d’objets étrangers à la communauté, tel qu’un ennemi extérieur, le second, à la fois plus proche et moins romanesque, naît des divisions et des conflits verticaux inhérents à toute société, c’est-à-dire des inégalités de pouvoir, de statut et de richesse – si avantageux pour leurs bénéficiaires et si néfastes pour les autres – qui la structure. C’est dans de telles injustices, qu’il contribue à perpétuer, que ce second type de peur plonge ses racines. S’il est sans doute excessif d’affirmer qu’elle constitue le fondement de l’ordre politique et social, cette forme de peur est si étroitement liée aux différentes hiérarchies de la société, ainsi qu’à l’autorité et à la soumission que celles-ci engendre, qu’elle représente un mode essentiel de contrôle politique et social.
Corel Robin, La peur, Histoire d’une idée politique, page 32
La peur étant la prise de conscience d’un mal, et le mal la privation d’un bien, les hommes de pouvoir peuvent faire naître la peur rien qu’en menaçant l’individu de cette privation. Cela peut se traduire par une violence extrême, mais ce n’est souvent nullement nécessaire, comme l’illustre l’épisode du maccarthysme : dans ce cas, en effet, c’est l’emploi et la carrière professionnelle des individus qui se sont trouvés le plus souvent menacés.
Corel Robin, La peur, Histoire d’une idée politique, page 33
La peur n’est pas exclusivement du côté des faibles et la manipulation du côté des puissants ; les seconds ont souvent peur des premiers, soit à cause du sentiment de culpabilité que leur inspire l’injustice qu’ils commettent, soit par crainte anticipée d’une révolte qui s’en prendrait à eux pour les déposséder de leurs privilèges.
Corel Robin, La peur, Histoire d’une idée politique, page 33
Si la crainte constitue pour Hobbes une réaction à un danger réel, ses qualités théâtrales – ou, dirions-nous aujourd’hui, spectaculaires – ne sont pas non plus à négliger. La peur procède en effet de l’illusion d’un danger, amplifié parfois à outrance par l’État. Les périls de l’existence étant nombreux et divers, et les sujets ne craignant pas spontanément ceux que le souverain peut estimer qu’il est opportun de craindre, c’est à lui qu’il appartient de choisir ce dont le peuple doit avoir peur. L’État doit convaincre celui-ci, au moyen d’une dénaturation subtile mais nécessaire de la réalité, de redouter certains maux plutôt que d’autres. Cet attribut lui confère une latitude considérable pour définir, comme bon lui semble, les objets de crainte qui domineront les affaires publiques.
Corel Robin, La peur, Histoire d’une idée politique, page 47
Face au despote de Montesquieu gît ainsi, pantelante, la victime : l’individu anéanti. Ravalé au rang d’objet, il lui obéit « aussi infailliblement (…) qu’une boule jetée contre une autre ». Quand il se soumet, c’est sans résistance, sans opposition, par le seul jeu d’un mouvement physique répondant à un autre. Idéalement, la simple menace de la violence, plutôt que la violence elle-même, suffit à le contraindre à l’obéissance. « On a reçu l’ordre et cela suffit. » Pour produire cette mécanique parfaite du pouvoir, « il faut ôter tout » au sujet : sa volonté, son individualité, son humanité même. Ainsi le despote menace-t-il davantage que le seul corps physique. Il ôte à la victime sa « volonté propre », ce qui la rend incapable de formuler des préférences, de prendre des décisions ou d’agir de façon autonome. La victime est dépouillée de ces besoins intérieurs – goûts, croyances, désirs – qui font se dresser les hommes contre le monde. Sans ces singularités qui font de chacun un être unique, elle ne peut plus se « préférer [elle-même] aux autres », mais seulement « à rien ». Elle est incapable d’imaginer l’avenir et de penser à des objectifs de long terme. Elle est tellement occupée à répondre à la violence qui lui est faite ou à sa menace qu’elle ne peut sentir à quel point ses actions nuisent à ses véritables intérêts. « Quand les sauvages de la Louisiane veulent avoir du fruit, ils coupent l’arbre au pied et cueillent le fruit. Voilà le gouvernement despotique. » La victime ne peut pas penser en termes de causalité. « (…) Quant à l’enchainement des évènements, ils ne peuvent le suivre, le prévoir, y penser même. » Il faut que la raison elle-même soit étouffée par la terreur, car une personne douée de raison peut défier et triompher du despote.
Corel Robin, La peur, Histoire d’une idée politique, page 81
Comme Montesquieu, Tocqueville nous offre deux visions différentes de la peur, situées à deux étapes de sa vie ; dans son cas, cependant, ces deux visions se partagent le même ouvrage. De la démocratie en Amérique, dont le premier volume fut publié en 1835 et le second en 1840. Dans le premier, Tocqueville affirme que la peur est un problème politique que des moyens politiques peuvent parfaitement suffire à résoudre : l’inquiétude est l’arme d’une majorité omnipotente et tyrannique, dont le pouvoir procède de la loi, de l’idéologie et des institutions, et qui ne laisse de soumettre la minorité à la menace de l’ostracisme. Comment éviter une telle tyrannie? En divisant et en décentralisant le pouvoir, et en encourageant l’émergence d’organisations locales et participatives : cela permettra de retirer à la majorité une part de son pouvoir et de transférer celle-ci à la minorité. Cette vision, sans être réjouissante, recèle la possibilité, si les pouvoirs sont effectivement séparés, de favoriser la liberté et d’apaiser l’inquiétude.
Mais, même dans ce premier volume, l’analyse de Tocqueville dévoile une réalité plus amère : si l’individu se conforme à ce que lui dicte la majorité, ce n’est pas en raison d’un quelconque défaut dans l’équilibre des pouvoirs, pas plus qu’en raison des lois, de l’idéologie ou des institutions, mais parce qu’il est trop faible, psychologiquement, pour défendre et revendiquer sa liberté. Dans le second volume, cette psyché affaiblie s’élargira aux dimensions d’une culture de masse s’étendant bien au-delà de la politique et de la sphère du pouvoir – presque au-delà de toute espérance. Ainsi, du fait de son besoin désespéré d’appartenance, il n’est même pas nécessaire de terroriser l’individu moderne et démocratique pour le contraindre à l’obéissance : inquiet du seul fait de son incapacité à exprimer sa volonté, il est prêt, sans qu’il soit besoin de l’y encourager, à renoncer de lui-même à sa liberté. Tandis que, dans le premier volume de De la démocratie en Amérique, l’idéologie, les lois et les institutions contribuent à créer une culture de la tranquillité, le second est dominé par une vision plus sombre, où les solutions d’ordre politique sont pratiquement impuissantes face à la culture préexistante de la solitude qui s’est emparé de la société démocratique. Ce second volume représente plus qu’un simple changement de perspective ; c’est un rejet complet du tableau peint dans le premier, dont Tocqueville est venu à penser qu’il était « distendu, commun et faux », et à la place duquel il propose maintenant « le tableau vrai et original » de la vie moderne.
Corel Robin, La peur, Histoire d’une idée politique, pages 96 et 97
L’homme démocratique, en revanche, est intérieurement rongé par un sentiment de faiblesse qui ne reflète pourtant aucun manque objectif de puissance. Son absence de confiance en soi est si profonde qu’il est impossible de dire jusqu’où « s’arrêteraient (…) les complaisances de [sa] faiblesse ». Spontanément enclin à ne pas résister aux exigences d’autrui, il n’est nullement besoin de la menacer d’ostracisme pour qu’il se conforme à la volonté de la foule. Son caractère, ou plutôt son manque de caractère, lui fait naturellement craindre tout ce qui peut irriter la majorité. L’autorité de celle-ci l’enveloppe d’une sorte d’atmosphère pesante et pénétrante. Sans qu’il soit nécessaire de recourir à la menace ou à des exhortations, le sujet démocratique intériorise de lui-même les opinions de la majorité. Sa volonté de s’y soumettre est si totale qu’il abandonne les opinions et les goûts particuliers qui auraient pu le conduire à y faire obstacle. La majorité « agit sur la volonté autant que sur les actions, et empêche en même temps le fait et le désir de faire ». Il ne lui est pas besoin de condamner les « livres licencieux », car personne n’est « tenté de les écrire ». Ou, comme Tocqueville l’écrira dans le second volume de son œuvre, « cette opinion toute-puissante finit par se glisser dans l’âme même de ceux que leur intérêt pourrait armer contre elle; elle modifie leur jugement en même temps qu’elle subjugue leur volonté ».
Corel Robin, La peur, Histoire d’une idée politique, page 103
Le libéralisme de l’inquiétude dissimule une tout autre conception, plus sombre et plus subversive, de l’ordre social. Reprenant un argument développé par nombre de penseurs, depuis Tocqueville jusqu’à l’École de Francfort, en passant par Christopher Lasch, ses partisans pensent qu’une des vertus de l’ordre social est de fournir à l’individu l’adversaire dont il a nécessairement besoin. L’ordre social fait en effet peser sur celui-ci un certain nombre d’exigences, parmi lesquelles le respect des règles qu’il édicte et l’obéissance. Ces contraintes favorisent souvent l’apparition d’individus rebelles, qui s’attachent à ce en quoi ils croient et sont prêts à prendre des risques au nom de cet attachement : un Martin Luther King ou une Anna Karenine, dont le refus des normes établies a marqué l’histoire et la littérature, et qui se sont dressés pour dire : « Voilà ce que je crois. Je n’en démordrai pas. » Dans sa révolte contre l’oppression, l’individu définit ses propres croyances et ses propres principes, et cela, de façon bien plus résolue que s’il vivait sous le regard assoupi de parents trop complaisants. Pour montrer une intransigeance aussi profonde, l’individu doit nécessairement sentir peser sur lui l’ensemble de la structure sociale. Sans celle-ci, la rébellion ne sera que superficielle et triviale ; la liberté, un geste dénué de sens. « La liberté radicale, souligne Walzer, est quelque chose de bien petit tant qu’elle ne se déploie pas dans un monde qui lui oppose une solide résistance. » Et « plus il lui est facile » de s’échapper, plus l’individu sera faible. Ou, pour citer Galston, « le choix rationnel d’un mode de vie est bien plus significatif (je suis tenté de dire qu’il peut seulement être significatif) si les enjeux le sont aussi, c’est-à-dire si l’individu amené à faire ce choix possède de fortes convictions auxquelles des convictions contraires peuvent être opposées. »
Walzer, On Toleration, p. 91 ; « The Communitarian Critique of Liberalism », p. 69 ; Galston, “Civil Education and the Liberal State”, in Nancy Rosenblum (dir.), Liberalism and the Moral Life, p. 101. Voir aussi Taylor, The Ethics of Authenticity, p. 37-41, 57 ; Richard Rorty, Achieving Our Country, p. 24-25.
Corey Robin, La peur, histoire d’une idée politique, pages 166 et 167
« Au XXème siècle, l’idée d’universalité humaine repose moins sur l’espoir que sur la peur ; moins sur une foi optimiste dans l’aptitude de l’homme au bien que sur la crainte que suscite son aptitude au mal ; moins sur une vision de l’homme comme acteur de son histoire que sur celle d’un être qui reste un loup pour ses semblables. Les étapes qui ont mené à ce nouvel internationalisme ont pour nom Arménie, Verdun, front russe, Auschwitz, Vietnam, Cambodge, Liban, Rwanda et Bosnie. Hommes, femmes ou enfants, civils ou militaires, ce siècle de guerres totales a fait de nous tous des victimes. »
Micheal Ignatieff, The Warrior’s Honor: Ethnic War and the Modern Conscience, New York, Henry Holt, 1997, p.18-19.
Cité par Corey Robin, La peur, histoire d’une idée politique, page 178
Si Ignatieff et ses collègues libéraux ont vu dans la lutte contre le nettoyage ethnique une occasion de renouveau progressiste, Kaplan et les siens y ont au contraire trouvé une opportunité de renouveau conservateur. Une nouvelle génération de guerriers impériaux était appelée à délivrer l’Occident de la médiocrité culturelle et de la vie facile. Plus païens que bourgeois, plus intuitifs que rationnels, ces guerriers ne seraient pas incarnés par Colin Powell : ce ne seraient pas de professionnels rigoureux, aussi à l’aise dans les couloirs des Nations unies que dans les arcanes bureaucratiques du Pentagone. Ils en appelaient au contraire à « quelque chose d’ancien et de traditionnel ». Les forces spéciales des États-Unis dans le Tiers-Monde, écrit Kaplan, allaient « recréer des forces expéditionnaires coloniales dont les hommes seraient des sortes de caméléons, sur le modèle de Sir Richard Francis Burton, cet homme qui fut à la fois espion, linguiste et maître ès déguisements. Une pensée « ambiguë », « subjective » et « intuitive », des décisions prises avec seulement 20% d’informations disponibles seraient encouragées : si l’on attendait d’en savoir davantage, il serait trop tard pour passe à l’action (1) ». Ces romantiques promoteurs de la guerre trouvaient leur alter ego diplomatique dans des hommes comme Henry Kissinger et Richard Nixon, dont l’habileté politique empruntait aux modèles d’autrefois. Kissinger, écrit Kaplan, avait une façon toute particulière de considérer la politique étrangère, comme s’il s’agissait d’une façon de « faire l’amour », créative et inventive, « intensément humaine », sensible au génie particulier de chaque individu et à la singularité de chaque situation, et il refusait de s’en tenir à l’application de règles schématiques (2). En bombardant illégalement le Cambodge et en continuant la guerre au Vietnam alors qu’elle n’avait plus d’utilité, Nixon et Kissinger ont montré un mépris aristocratique pour la masse et démontré qu’il était encore possible, dans un univers de désenchantement, de faire preuve de caractère. « N’est-ce pas là précisément la manière dont nous voudrions, ou du moins dont nous disions que nous voudrions, que nos dirigeants agissent? N’est-ce pas là ce qui a tant irrité chez le président Clinton et chez d’autres hommes politiques : que leur action se contente de suivre les sondages d’opinion et non leurs convictions (3)? » Dans une décennie qui a vu « s’épanouir une forme particulièrement insipide de médiocrité », conclut Kaplan, nous devons saluer « l’inflexible fermeté »d’un Kissinger ou d’un Nixon, leur capacité de se porter « à de cruelles extrémités (4) ».
(1) Kaplan, p. 108.
(2) Kaplan, p. 143.
(3) Kaplan, p.147.
(4) Kaplan, p 154.
Corey Robin, La peur, histoire d’une idée politique, pages 187 et 188
La société civile, presque en totalité, a un lien avec l’État, mais une part considérable de son activité se déroule en dehors de la sphère gouvernementale. C’est, en théorie, ce qui fait de la société civile une source de liberté. Du fait de sa position extérieure par rapport aux instances de pouvoir, les individus peuvent vaquer à leurs occupations sans craindre la coercition de l’État. Dans le domaine politique, la société civile est supposée offrir des possibilités de mobilisation par le biais d’une pression morale, et non par la force. Dans les autres domaines, elle offre de quoi équilibrer les demandes pressantes du pouvoir politique. Si nous fréquentons les lieux de culte, si nous passons quatre nuits par semaines à la maison et trois autres à jouer au bowling, le gouvernement ne peut prétendre régir la totalité de notre existence. Si Madison n’a jamais parlé de la société civile, elle fait pourtant écho à l’une de ses réflexions, à savoir que la diversité est source de liberté : « En englobant dans la société tant de citoyens si différents », le pluralisme « rend très improbable la constitution d’une majorité injuste (1) ».
Voilà pour la théorie. Mais la pratique s’avère tout autre. La société civile, même dans le régime le plus libéral, est souvent soit un facteur de répression qui s’ajoute à l’État, soit un facteur de répression autonome (2). Dans les démocraties libérales en particulier, où le pouvoir de l’État est limité, les élites ont de nombreux moyens pour utiliser la société civile en vue de propager la peur. Sans que ce soit une règle absolue, on peut tout de même affirmer que plus un régime est libéral, plus la société civile apparaît comme un instrument séduisant de peur. Examinons les statistiques suivantes. Lors de la Guerre Peur rouge des années 1919-1920, le gouvernement des États-Unis fit emprisonner 10 000 personnes et en déportant environ 600 (3). Pendant le maccarthysme, les limites imposées à l’État par la nature libérale du régime permirent de réduire le nombre de personnes emprisonnées à environs 200, et le nombre de déportés à quelques individus. Pourtant, le maccarthysme dura plus longtemps, toucha davantage d’individus, infligea des dommages plus grands et, sur la durée, eut une influence bien plus importante sur la nation et son régime. Plusieurs éléments permettent de l’expliquer. La guerre froide n’en est pas le moindre, et en particulier l’implication plus grande de la société civile, et surtout du lieu de travail, dans la répression : si le gouvernement a sanctionné un nombre limité d’individus, entre 20 et 40% des salariés du pays ont fait l’objet d’une enquête de loyauté sur leur lieu de travail (4).
Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi la société civile peut servir de substitut ou de complément à la répression de l’État. La société civile n’est pas, dans l’ensemble, soumis à des restrictions comme le Bill of Rights. Ce que l’État n’a pas le droit de faire, des acteurs privés au sein de la société peuvent le faire à sa place.
(1) Federalist 51, p.321.
(2) Robert D. Putnam, Bowling Alone : The Collapse and Revival of American Community, New York, Simon and Schuster, 2000, p. 22-24, 350-363. Voir aussi Amy Gutmann, « Freedom of Association : An Introductory Essay », in Freedom of Association, Princeton, Princeton University Press, 1998, p. 3-32.
(3) William Preston Jr., Aliens and Dissenters : Federal Suppression of Radicals, 1903-1933, New York, Harper and Row, 1963, p. 221 ; Robert K. Murray, Red Scare : A Study in National Hysteria, 1919-1920, New York, McGraw-Hill, 1955, p. 251 ; Robert Justin Goldstein, Political Repression in Modern America : From 1870 to Present, Cambridge, Schenkman, 1978, p. 156, 160.
(4) Brown, p. 181 ; Griffin Fariello, Red Scare : Memories of the America Inquisition, New York, Avon, 1995, p. 43.
Corey Robin, La peur, histoire d’une idée politique, pages 259 et 260
Dans le cours naturel de l’existence, le pouvoir que l’on a sur les moyens de subsistance d’un homme équivaut à un pouvoir sur sa volonté.
Alexander Hamilton
Cité par Corey Robin, La peur, histoire d’une idée politique, page 271
Il est encore un aspect de la question qu’il nous faut garder à l’esprit : la peur est, elle aussi, une forme de travail. Créer et entretenir la peur suppose tout un ensemble d’actions : faire planer une menace de sanction, élaborer une propagande, répandre des rumeurs, etc. Ces actions ne sont ni spontanées ni accidentelles : elles exigent un effort continu de la part des élites et de leurs collaborateurs. Pour que la peur soit entretenue dans la durée, les individus appelés à y participer doivent être engagés, payé, encadrés et promus. La peur est ainsi une entreprise économique qui attire et fidélise ses employés en leur promettant un travail et une perspective de progrès personnel. À l’apogée de l’impérialisme européen, Disraeli eut ce mot : « L’Orient est une carrière." (1) La peur a également été une carrière aux États-Unis, non seulement pendant le maccarthysme et sous le règne de la discrimination raciale, mais aussi lors de la lutte menée contre les syndicats dans la dernière moitié du siècle dernier. Pour appréhender la peur, il nous faut donc pleinement comprendre ce qui se passe au travail et sur le lieu de travail.
(1) Cité dans Edward W. Said, Orientalism, New York, Vintage, 1978, 1994, p. xiii.
Corey Robin, La peur, histoire d’une idée politique, pages 274 et 275
Ne les accoutume pas
À la drogue du danger –
Au rêve d’un ennemi
Qui doit être foulé au pied, comme l’herbe –
Avant qu’ils puissent goûter la liberté.
Eschyle
Cité par Corey Robin, La peur, histoire d’une idée politique, page 296
À l’aube de l’État moderne, le cardinal de Richelieu eut cette pensée : « Dans les affaires ordinaires, l’administration de la justice requiert des preuves véritables ; il n’en va pas de même des affaires de l’État… Là, une circonstance urgente peut parfois tenir lieu de preuve ; la perte d’un particulier ne peut se comparer au salut de l’État (1). » À mesure que nous gravissons l’échelle des menaces, du crime ordinaire à la destruction de l’État, suggère Richelieu, de moins en moins de preuves sont nécessaires pour attester de la réalité de la menace. Trois siècles plus tard, en pleine guerre froide, le juriste américain Learned Hank reformulera ce principe en écrivant que « la gravité du « mal » » doit être « corrigée par son improbabilité (2) ». Plus grand est le mal, plus haut est le degré d’improbabilité que nous demandons pour ne pas nous en inquiéter, plus bas le degré de probabilité qui autorise – ou permet – de lancer une action préemptive à son encontre.
Même dans un laboratoire ou dans un séminaire, cette logique antiseptique du risque peut induire des actes de démence inspirée. En craignant un danger d’une ampleur inconnue, un dirigeant rationnel, ou un ordinateur, pourrait nous contraindre à faire la guerre contre une menace entièrement inexistante. Mais les dirigeants d’une démocratie moderne tiennent compte d’un facteur de pression supplémentaire. Responsables de populations entières et dépendant des électeurs pour leur réélection, ils se préoccupent non seulement de la survie de la nation mais aussi de leur propre carrière. Le coût électoral de la sous-estimation d’une menace, même imaginaire, peut s’avérer aussi élevé, voire plus, que son coût stratégique ; mais le coût électoral de la surestimation d’une menace est souvent, en revanche, assez bas (comme l’a montré la réélection de George W. Bush). « Mieux vaut être méprisé pour excès de prudence, écrit Burke, que ruiné par excès de confiance (3)
(1) Cité dans Otto Kircheimer, Political Justice : The Use of Legal Procedure for Political Ends, Princeton, Princeton University Press, 1961, p.30.
(2) United States v. Dennis et al., 183 F.2d 212 (1950).
(3) Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France (éd. J.C.D. Clark), Stanford, Stanford University Press, 2001, p. 154.
Corey Robin, La peur, histoire d’une idée politique, pages 305 et 306
L’une des tâches principales de tout gouvernement en guerre est la promotion et l’entretien, à travers la propagande et la coercition, d’un consensus public concernant l’intérêt national et les buts de guerre du pays. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral s’est toujours appuyé sur les industries de la culture pour y parvenir. En tant qu’industries de la culture, les médias et les universités sont de naturels véhicules de propagande ; en tant qu’industrie culturelles, elles offrent des instruments puissants de coercition, d’abord au moyen de l’embauche et du licenciement, puis à travers d’autres modes de sanction financiers et économiques. Aussi n’est-il pas étonnant que ces institutions fassent l’objet, depuis quelques années, d’un sérieux examen politique. Ce qui est moins visible, en revanche, c’est la part de coercition et de propagande que ces institutions acceptent d’assumer elles-mêmes de façon volontaires – ou pour éviter l’intrusion du gouvernement et d’éventuelles sanctions.
Corey Robin, La peur, histoire d’une idée politique, page 320
La peur à l’américaine n’est ni une sombre conspiration ni un complot diabolique. C’est simplement le résultat de ce qui arrive quand les gens se contentent de poursuivre leurs intérêts. C’est business as usual, une journée de plus au bureau, bref, l’œuvre tranquille – et perverse – de la main invisible d’Adam Smith.
La peur en politique, comme l’observait Hobbes, a deux visages : l’un regarde au loin, vers les ennemis auxquels la nation fait face ; l’autre regarde en soi-même, vers les conflits et les inégalités qu’entretient la nation. L’astuce du pouvoir politique est de convertir le premier en second, d’utiliser la menace des ennemis à l’extérieur comme prétexte pour réprimer les ennemis à l’intérieur. À cet égard, les membres des cercles gouvernementaux et des élites politiques après le 11 septembre ont remarquablement réussi. Ils ont tranquillement tourné les armes de la guerre antiterroriste contre les mouvements qui, dans le pays, tentaient de renverser le cours des choses. Et alors même que le bruit et les cahots de l’appareil de peur s’évanouissent de la vie publique, les engrenages de cette mécanique continuent de tourner, faisant d’un pays déjà répressif un pays plus répressif encore. « Un jour, la guerre contre le terrorisme prendra fin », ai-je écrit à la fin de l’introduction. « Comme toutes les guerres. Et quand cela arrivera, nous nous trouverons vivre encore dans la peur. Non pas la peur du terrorisme ou de l’islam radical, mais celle des dirigeants que la peur aura laissés derrière elle. » Voilà, je le crains, une prédiction qui pourrait bien se réaliser.
Corey Robin, La peur, histoire d’une idée politique, pages 322 et 323